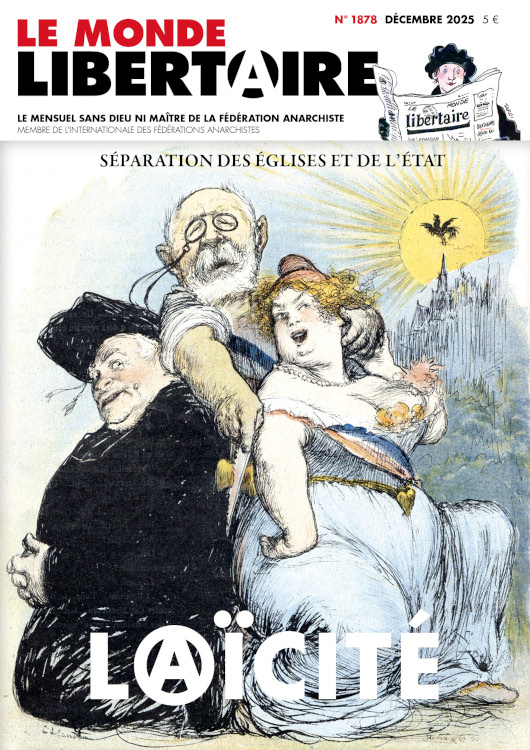La fin de l’anarchisme ?
Texte de 2006
La publication la semaine dernière du texte "Que ce passe-t-il ?" de Guy du groupe de Rouen a rappelé à René Berthier un débat qu’il avait animé en 2006 dans cette ville célèbre pour ses incendies de 1431 et de 2019. Il nous a fais parvenir le texte de son intervention.
La fin de l’anarchisme ?
René Berthier

Après la chute du mur de Berlin on a beaucoup parlé de la fin du communisme. La question que je pose est : ne serait-il pas temps de parler de la fin de l’anarchisme ?
Certains camarades ont pu penser qu’après l’effondrement de l’URSS le mouvement anarchiste allait enfin pouvoir s’exprimer, se développer : Le communisme maintenant définitivement abattu, en grande partie par ses propres erreurs, avait été la principale entrave au développement de l’anarchisme par l’illusion de socialisme qu’il proposait aux masses ; mais maintenant la voie était libre au développement d’une véritable alternative au capitalisme.
Presque vingt ans plus tard il faut bien constater que pas grand-chose n’a changé au caractère confidentiel dans lequel se trouve le mouvement anarchiste dans ses différentes et multiples formes.
Au cours de son histoire le mouvement anarchiste n’a pas toujours été un mouvement confidentiel confiné à l’action marginale sans pouvoir intervenir sur le cours des événements.
Si le public connaît l’anarchisme par les attentats du début du siècle ou par les quelques individus, que les médias qualifient d’anarchistes, qui cassent des vitrines à la fin des manifestations d’aujourd’hui, il ignore que les formes les plus vivaces, les plus dynamiques, les plus constructives sous lesquelles il est apparu ont au contraire été des mouvements de masse.
A la fin de la Seconde guerre mondiale, l’anarcho-syndicalisme avait pratiquement disparu : des dizaines de milliers de militants avaient été massacrés par la répression armée, non seulement en Espagne, mais en Europe centrale, en Amérique latine, aux États-Unis. Le mouvement ne s’en est jamais remis.
Pourtant, s’il n’est pas possible d’évacuer les causes externes à la faiblesse du mouvement d’aujourd’hui, il serait injuste de ne pas évoquer les causes internes. Pour dire les choses simplement, l’anarchisme s’est fondé sur un discours qui pouvait être pertinent il y a un siècle mais qui, s’il est repris tel quel, est dépassé aujourd’hui.
La critique du capitalisme, développée par les anarchistes en 1870, s’appuyait sur un certain nombre de carences du système qui n’existent plus aujourd’hui dans les mêmes proportions. La misère de masse de la classe ouvrière des pays industriels ne s’est pas accrue avec le développement du capitalisme. Le niveau de vie moyen s’est amélioré. Le capitalisme a su s’adapter et mettre au point une législation qui offre des garanties, minimales certes, à la majorité de la population. Cette législation a souvent été le résultat de luttes très âpres de la classe ouvrière. Les causes principales de la misère, dénoncées il y a plus d’un siècle, ont été en partie – en partie seulement – atténuées par la législation sociale. L’assurance maladie, l’assurance vieillesse sont des conquêtes de la classe ouvrière, mais on en trouve les prémisses dans les théories mutuellistes de Proudhon. Ces conquêtes sont aujourd’hui sérieusement remises en cause par les politiques néolibérales, mais il ne semble pas, pour l’instant que ces attaques annoncent un renouveau de luttes de masse. Si ces remises en cause suscitent une réelle indignation, elles restent circonscrites.
La misère effroyable du prolétariat que décrit Proudhon dans le Système des contradictions économiques, ou celle que décrit Marx dans le Capital, n’existent plus, du moins dans les pays industriels.
La journée de huit heures, les congés payés sont également des conquêtes obtenues de haute lutte. Or il ne faut pas oublier que certains anarchistes de la fin du siècle dernier se sont opposés à la réduction du temps de travail parce qu’en améliorant les conditions de vie des travailleurs, cela aurait conduit, disaient-ils, à une désaffection de la classe ouvrière envers la révolution. C’était là une vision stratégique suicidaire. L’élimination de l’anarchisme de la scène sociale est en partie due au fait que, à partir de la fin du siècle dernier, l’intelligence politique du système capitaliste était beaucoup plus grande que celle des anarchistes.
Dans les débats au sein de l’Association internationale des travailleurs se trouvaient déjà les germes de cette évolution. L’anarchisme s’est alors développé de façon massive dans les régions où le pouvoir politique faisait face aux ouvriers avec la répression la plus féroce ; il ne s’est pas développé dans les régions où les réformes politiques et sociales ont été mises en place en grande partie à l’initiative du pouvoir.
Pour illustrer ce propos, je donnerai deux exemples : l’Espagne et l’Allemagne.
En Espagne, le mouvement ouvrier trouvait systématique¬ment face à la lui violence d’État au service des capitalistes et des grands propriétaires fonciers. Là où le pouvoir répond par la violence la plus extrême à la moindre exigence d’amélioration des conditions de vie des travailleurs, le réformisme n’a tout simplement pas sa place. Un salarié qui revendiquait devenait inévitablement révolutionnaire.
En Allemagne, des réformes sociales avaient été mises en place par le pouvoir lui-même : c’est Bismarck qui a instauré la première forme d’assurance sociale. Les socialistes avaient des élus au Parlement. Mais en 1891 Engels se plaint que, malgré l’instauration d’un système représentatif, «le gouvernement possède tout pouvoir exécutif» et que les «chambres n’ont pas même le pouvoir de refuser les impôts». «La crainte d’un renouvellement de la loi contre les socialistes paralyse l’action de la social-démocratie», dit-il encore, confirmant l’opinion de Bakounine selon lequel les formes démocratiques n’offrent que peu de garanties pour le peuple. Le «despotisme gouvernemental» trouve ainsi une forme nouvelle et efficace dans la pseudo-volonté du peuple. On a là une situation inverse à celle de l’Espagne.
En Espagne, toute réforme se heurtait à la répression, qui alimentait le mouvement révolutionnaire ;
En Allemagne, les lois antisocialistes pouvaient être mises en place malgré la présence de socialistes au parlement, parce que par ailleurs la voie aux réformes sociales ne semblait pas bouchée, ce qui fait qu’un mouvement révolutionnaire ne s’est pas développé.
Entre l’Espagne et l’Allemagne, la France se trouvait dans une situation intermédiaire. Il y eut un mouvement révolutionnaire, le syndicalisme révolutionnaire, dont l’apogée se trouva entre les années 1900 et 1905. Mais différents facteurs intervinrent pour l’affaiblir. Tout d’abord l’unification du parti socialiste en 1905, qui fournit un autre pôle d’identification à la classe ouvrière ; ensuite, par le jeu des élections internes à la CGT, le progressif remplacement des élus révolutionnaires par des réformistes ; enfin la répression systématique, y compris par les armes, de tout mouvement de contestation révolutionnaire, qui conduisit la direction confédérale à prioriser la négociation plutôt que la confrontation. En résumé le mouvement révolutionnaire en France fut vaincu non parce qu’il fit des erreurs, mais par l’action combinée de la répression étatique et de l’apparition d’une alternative parlementaire.
Le raidissement du pouvoir dans le sens de la répression au service de la bourgeoisie suscita naturellement la constitution d’un mouvement révolutionnaire – et, jusqu’à la fondation du parti bolchevik, le seul mouvement révolutionnaire dans le mouvement ouvrier européen était le syndicalisme révolutionnaire, puis l’anarcho-syndicalisme. Mais le risque était peut-être que les militants finissent par perdre de vue que l’objectif était tout de même l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Dans tout processus où la violence est le moyen systématique pour parvenir à une fin (défense des travailleurs du point de vue des militants ouvriers ; attaque contre les travailleurs du point de vue de l’État), lorsque cette situation dure trop longtemps, l’objectif finit par se dissoudre et le moyen devient la fin. A partir du moment où ce processus de recours systématique à la force est brisé et que s’instaure une certaine forme de négociation, de médiation, on assiste à une situation où, individuellement, les militants peuvent se trouver désemparés [note] et, politiquement, le mouvement révolutionnaire se trouve incapable de s’adapter et régresse au niveau de petits groupes.
Il devient clair que les concessions accordées par le système (négociations en économie et système représentatif en politique) furent le moyen le plus efficace d’enrayer toute dynamique révolutionnaire. Or les anarchistes ne semblaient pas avoir compris que ce processus était irréversible, qu’il introduisait une nouvelle donne dans les relations entre le mouvement révolutionnaire et la classe ouvrière, à laquelle il fallait s’adapter ou disparaître.
Par exemple, les anarchistes ont mal analysé ce qui a fait pendant des décennies la force du parti communiste. Du point de vue étroit des anarchistes, le PC apparaissait comme un parti « réformiste » et parlementariste. Or, dans le discours interne du PC, les « réformistes » désignaient les socialistes et les syndicalistes qui n’étaient pas sous l’influence du PC. Les cadres du parti communiste transmettaient aux nouveaux militants l’idée que le parti était révolutionnaire ; seulement, on mettait les méthodes d’action révolutionnaires en sourdine parce que le moment n’était pas venu. Quant au parlementarisme du PC, c’était une chose tout à fait théorique. Les militants aguerris du PC savaient bien qu’ils ne prendraient pas le pouvoir par les urnes, et l’action parlementaire était elle-même une tactique temporaire que ces militants considéraient avec une certaine ironie. Le parti communiste avait dans ses rangs un noyau dur de militants prêt à passer à l’action si c’était nécessaire [note] .
D’une certaine manière, on peut dire que le PC s’était adapté à l’évolution de la société, en conservant, ne serait-ce que de manière formelle, son projet et son discours révolutionnaires. De cette façon, malgré le fait que les militants les plus avertis savaient qu’il ne parviendrait jamais au pouvoir par les élections, la masse des adhérents et sympathisants gardait l’image d’un parti qui défend indéfectiblement les travailleurs. Le déclin du parti communiste a commencé le jour où il a abandonné cette « mythologie » révolutionnaire. Les militants étaient parfaitement capables de comprendre qu’ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir, pour l’instant, et qu’il fallait attendre le bon moment, qu’il fallait faire des concessions temporaires, etc., et leur patience était soutenue par le maintien de cette « mythologie » : dictature du prolétariat, lutte des classes, avant-garde, etc. Un jour, la direction du parti a dit : maintenant on fait la vérité des prix, on se montre comme ce qu’on est en réalité, un parti qui négocie des accords de merde avec des alliés de merde pour avoir des gamelles ministérielles. Le parti s’est intégré dans un système qui se voulait consensuel en faisant ce que Bakounine appelait des « alliances contre nature » pour décrocher des postes ministériels. On ne parle plus de lutte des classes mais de « luttes citoyennes ».
Dès lors, le parti communiste cessait d’être le parti mythologique de la classe ouvrière et devenait un parti comme les autres, comme il y en avait à la pelle. Fin du parti communiste. En somme, le parti communiste – sa direction – s’est pris à son propre piège et, en voulant avoir quelques ministres, il a perdu beaucoup de députés. Mon opinion est que les anarchistes n’ont pas à se réjouir d’une telle situation.
L’opposition des anarchistes à la participation aux élections est-elle due au caractère intrinsèquement faussé de cette pratique politique, ou est-elle motivée, inconsciemment, par le fait que les élections peuvent conduire à une amélioration des conditions d’existence des masses ? Les anarchistes du XXe siècle ne se sont pas posés la question d’une stratégie politique adaptée à un contexte où les réformes sociales, certes partielles, deviennent une pratique courante. L’amélioration des conditions d’existence des masses est-elle antinomique avec le projet anarchiste ? Les anarchistes de la seconde moitié du XXe siècle n’ont pas vu que beaucoup de ce que réclamaient Proudhon et Bakounine est devenu une banalité aujourd’hui.
En effet, si on recense les différentes revendications que formulaient les deux révolutionnaires du XIXe siècle, on s’aperçoit qu’elles sont, pour une large part, mises en œuvre aujourd’hui, ou qu’elles constituent des revendications formulées encore aujourd’hui sans qu’elles aient la moindre connotation révolutionnaire ou subversive.
Lorsque Proudhon entame sa critique de la propriété, il faut comprendre qu’il se place dans le cadre juridique hérité de 1789 et du code napoléonien, qui avaient érigé la propriété en droit absolu. Le propriétaire avait tous les droits : d’user et d’abuser de son bien, c’est-à-dire même de le détruire. Ce droit absolu s’appliquait à la terre, aux biens immobiliers, à l’outillage. La propriété était sacrée, elle seule était le garant de l’ordre social. Or, en 1840, le garant de l’ordre social pour Proudhon aurait dû être l’égalité, « l’égalité au point de départ ».
En fait, la perspective de Proudhon est plutôt une sorte de réformisme radical. Il veut mettre en place des changements importants, mais pas par un chamboulement général, du jour au lendemain. Il ne veut pas faire « une Saint-Barthélemy de propriétaires », écrit-il à Marx le 17 mai 1846. Il ne conteste pas la propriété de celui qui travaille lui-même et fait valoir son patrimoine. Ce qu’il conteste, c’est le droit absolu de disposition dont bénéficie tout propriétaire qui ne participe en rien à la mise en valeur de son capital. Il conteste le droit qu’a tout propriétaire de bénéficier d’un « droit d’aubaine » (intérêt du capital) illimité dans le temps tandis que c’est un autre qui met en valeur son bien. Proudhon attaque donc l’institution de la propriété en tant que source d’oisiveté qui entretient un propriétaire absentéiste.
Le droit absolu de propriété, selon Proudhon, constitue une entrave à l’intérêt collectif. Les propriétaires terriens s’opposent à la rationalisation des cultures en refusant le remembrement d’un régime foncier qui compte cent vingt-trois millions de parcelles. Ils s’opposent à la cession de terrains qui permettraient la construction de routes, de canaux, améliorant la circulation des biens et des personnes. Ils s’opposent à l’exploitation du sous-sol qui peut produire des richesses minières. La remise en cause de ce droit propriétaire était subversive en 1850, elle est banale aujourd’hui.
En 1851 Proudhon décrit une situation dramatique héritée de la révolution de 1848, qu’il pense être la conséquence d’une grave crise économique. Il analyse alors la crise du logement à Paris [note] . La situation est suffisamment grave, pense-t-il, pour qu’il faille mettre en place un plan d’urgence. On punit l’agiotage sur le pain et les denrées de première nécessité : «Est-ce un acte plus licite de spéculer sur l’habitation du peuple ?»
Aussi Proudhon propose-t-il que «tout paiement fait à titre de loyer sera porté en a-compte de la propriété, celle-ci estimée au vingtuple du prix de la location» ; de même, «tout acquittement de terme vaudra au locataire part proportionnelle et indivise dans la maison par lui habitée». Enfin, «la propriété ainsi remboursée passera à fur et mesure au droit de l’administration communale» qui «leur garantira à tous, à perpétuité, le domicile, au prix de revient du bâtiment».
Les communes pourront «traiter de gré à gré avec les propriétaires, pour la liquidation et le remboursement immédiat des propriétés louées». Elles pourront dans ce cas opérer une diminution des loyers en reportant l’amortissement sur trente ans. Les réparations, l’agencement, l’entretien des édifices ainsi que les constructions nouvelles seront confiés par la commune à des «compagnies maçonnes ou associations d’ouvriers en bâtiment».
Quant aux propriétaires qui occupent leurs propres maisons, ils «en conserveront la propriété aussi longtemps qu’ils le jugeront utile à leurs intérêts».
Ainsi, «une garantie plus forte que toutes les lois, toutes les combinaisons électorales, toutes les sanctions populaires, assure à jamais le logement aux travailleurs et rend impossible le retour à la spéculation locative. Il n’y faut ni gouvernement, ni législation, ni codes ; il suffit d’un pacte entre les citoyens, dont l’exécution sera confiée à la commune : ce que ne feront jamais ni dictateurs ni rois, le producteur, par une simple transaction, est logé.»
Si la perspective de Proudhon est réformiste, on pourrait préciser en disant qu’il s’agit d’un réformisme relativement radical, qui bousculait considérablement les idées de l’époque et les sensibilités facilement exacerbées des propriétaires chaque fois qu’on leur contestait leurs droits. Le réformisme aujourd’hui ne vaut plus à personne des années de prison. Beaucoup de ses idées, qui lui ont coûté sa liberté, sont devenues des lieux communs aujourd’hui. Plus de la moitié des Français sont maintenant propriétaires de leur logement. Les offices publics d’habitations permettent parfois le rachat de leur logement par les locataires en tenant compte (partiellement) des loyers versés. Il existe de nombreuses restrictions au droit de propriété, notamment lors d’expropriations pour raison d’intérêt public. Une législation complexe protège le droit des locataires.
On voit que les réclamations de Proudhon vers 1850 n’ont rien de particulièrement choquant aujourd’hui.
Il en est de même pour Bakounine : en 1866 il propose un programme dans lequel les chômeurs seraient pris en charge par la collectivité, ainsi que les vieillards et les malades. L’égalité des droits entre l’homme et la femme est également affirmée – point sur lequel Bakounine insistera toujours (en cela il diffère de Proudhon) : «La femme différente de l’homme, mais non inférieure à lui, intelligente, travailleuse, libre comme lui, est déclarée son égale.»
L’instruction devra être gratuite et obligatoire pour tous (les filles aussi, par conséquent) du primaire « jusqu’aux plus hautes institutions de perfectionnement, théorique et pratique, dans les sciences, dans les lettres, dans les arts et dans l’industrie ».
En 1870 en France, ces revendications étaient extrêmement subversives ; elles sont parfaitement banales aujourd’hui.
Il est vrai que ces revendications ne constituaient pas la totalité de ce que réclamaient les deux hommes : la gestion collective de la société par les travailleurs associés, ce qui reste encore aujourd’hui tout à fait révolutionnaire. Pourtant ils pensaient que ces revendications partielles ne pourraient pas être réalisées par la société capitaliste ; qu’elles ne pourraient l’être qu’après une révolution globale des rapports politiques et économiques. Or on s’aperçoit aujourd’hui que la société capitaliste a réussi à absorber une grande partie de ces revendications.
Je pense avoir été suffisamment clair en laissant entendre qu’on a tous besoin de «mythes», autrement dit de références positives pour guider notre action. Je préciserai une chose : Aujourd’hui, le principal problème du mouvement anarchiste, du mouvement social en général, c’est qu’il n’a pas de «mythe positif», il n’a pas de représentation collective concrète de ce que serait la société émancipée. Déambuler dans une manifestation avec une banderole «Autogestion» n’a strictement aucun sens. Tout le monde s’en fout de l’autogestion. Ce qui intéresse les gens, c’est comment on organisera la santé, la sécurité sociale, les transports, etc.
Le paradoxe du mouvement anarchiste est qu’il est souvent impliqué dans les luttes quotidiennes aux côtés des travailleurs, sans que cela ne pose de problème, mais qu’il semble incapable de mettre en place un programme d’action et de revendication intermédiaire, transitoire, qui pourrait attirer de nombreuses personnes.
Il suffirait d’un peu d’imagination...
Ca bouge aux Etats-Unis
LA TERREUR SOUS LENINE
Autres Brésils
Sempé est mort
États-Unis : le fossé religieux (3e partie)
États-Unis: le fossé religieux (2e partie)
États-Unis: le fossé religieux (1re partie)
Une médaille d’or pour le « Prix Nestor Makhno » ?
À propos des 34 démissionnaires de l’UCL
L’insurrection de Cronstadt, moment charnière de la Révolution russe (4e et dernière partie)
L’insurrection de Cronstadt, moment charnière de la Révolution russe (3e partie)
L’insurrection de Cronstadt, moment charnière de la Révolution russe (2e partie)
L’insurrection de Cronstadt, moment charnière de la Révolution russe (1e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (20e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (19e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (18e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (17e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (16e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (15e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (14e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (13e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (12e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (11e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (10e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (9e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (8e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (7e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (6e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (5e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (4e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (3e partie)
L’ Internationale syndicale rouge (2e partie)
Santé publique: Exigeons des comptes !!!
Revue d’études proudhoniennes
Histoire : L’Internationale syndicale rouge (1ère partie)
Pour un Nuremberg de la casse hospitalière
COVID-19 vs fondamentalistes protestants
"Eurabia". 4e et dernière partie
"Eurabia". 3e partie
"Eurabia". 2e partie
« Eurabia »
Guillaume Davranche : Dix questions sur l’anarchisme
Ancien article : Ordre moral et partouze sado-maso
Réflexions sur Proudhon et la propriété
Germinal juin 2019
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (9e partie)
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (8e partie)
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (7e partie)
La violence sociale est la pire des violences !
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (6e partie)
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (5e partie)
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (4e partie)
Des nouvelles du Brésil
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (3e partie)
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (2e partie)
Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme (1e partie)
« Policiers, suicidez-vous » ?
Les taureaux catalans pour l’indépendance ?
Terrorisme ou insurrectionalisme ?
Tierra y Libertad
Nito Lemos Reis
Portugal : Sortie du dernier numéro de la revue A Idea
feliz aniversario
Recension et commentaire du livre de Reiner Tosstorff, The Red International of Labour Unions (RILU) 1920-1937
Ordre moral et partouze sado-maso
1 |
le 13 février 2020 15:46:03 par René |
Précision : je n’ai pas "animé" ce débat, j’ai bien plus modestement contribué, avec d’autres, à ce débat. J’avais rédigé le texte que j’ai intitulé "La fin de l’anarchisme?" dans la perspective de ce débat mais naturellement je n’ai pas lui ce texte.
2 |
le 18 février 2020 09:59:08 par Eyaflalojokûl |
bonjour et merci pour cet article.
Mais non l’anarchisme n’est pas fini.
Certes il y a un écart des conditions de vie entre le début du 21 ème siècle et le 19 ième siècle. Mais ce n’est qu’un effet de façade.
Le travail tue et rend malade comme avant. Les aides sociales sont toujours soumises à conditions et maintiennent les individus sous le seuil de pauvreté. Des êtres humains sont toujours sans logement et vivent dans la rue.
De plus gouvernement après gouvernement, qu’ils soient de droite de gauche du centre ou que sais je encore, on assiste à un dé-tricotage, maille par maille des acquis sociaux, au nom de l’équilibre financier du budget de l’état. alors que de l’argent est gaspillé en armes, en train de vie somptueux des élus et autres fuites financières non justifiées au détriment du social.
Le travail ne donne aucun garantie d’avoir une vie décente au point de vu logement,nourriture, santé, épanouissement etc..
il y a encore beaucoup de travail et de luttes à mener.
La situation n’est pas formidable malgré quelques avancées.
De plus une fois qu’une société libertaire sera une réalité, elle ne sera pas finie mais vivante au quotidien et avec des projets d’avenir.
De plus il y à assez d’exemples de lieux et de régions auto gérées de part le monde, pour servir de réalité vivantes et à mettre en avant pour montrer ce que l’autogestion arrive à mettre en place, en dépassant parfois ce qu’un état fait pour ces pions que nous sommes.
Nous avons quand même un mensuel, une radio, trois sites ( F.A et ML Et RL ). Ce qui fait que la pensée libertaire n’intéresse peu ou pas certaines personnes, je n’ai pas de réponses. Et il doit y avoir autant de réponses différentes qu’il y à d’êtres humains sur terre.
Comment les y intéresser ? je n’ai pas de réponses, ni de méthodes.
Peut on dire que la politique est un sujet de méfiance généralisé et qu’on nous met dans le même sac que les politiciens élus ou des partis ?
La lutte n’est pas finie et ce n’est pas parce que nous ne sommes pas aussi nombreux qu’on le souhaiteraient qu’il faut abandonner notre beau projet!
Salutations respectueuses et libertaires.