Philosophie-sociologie > Les composantes existentielles de l’engagement libertaire (2e partie)
Philosophie-sociologie

par Stéphane Sangral • le 29 juin 2020
Les composantes existentielles de l’engagement libertaire (2e partie)
Lien permanent : https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=4934
Le texte qui suit a été publié sur le site www.grand-angle-libertaire.net dans le cadre d’un dossier "Des composantes existentielles de l’engagement libertaire"
L’engagement. Je n’ai jamais su ce que c’était. Je n’ai jamais été capable de penser en profondeur cette notion. En vérité je n’ai jamais réellement essayé. Intuitivement, disons grossièrement, je sais que j’en suis éloigné.

Donc…
Rappel :la semaine dernière, la première partie de cet article où il était question de points cardinaux...
V) Et c’est la carte d’une nouvelle éthique qui alors se dessine…
Redéfinissons une nouvelle fois l’Individuité :
Mouvement de conscience tendant à sacraliser le soi, le soi en soi, et non plus simplement, comme l’on est naturellement porté à le faire, ce cas particulier du soi qu’est le moi ; mouvement de conscience tendant à offrir, à partir du maigre pécule existentiel de l’individualisme, le multipliant par le nombre d’individus conscients, à chacun une fortune ; mouvement de conscience tendant à rendre caduque les dynamiques de luttes interindividuelles qui depuis l’apparition de la vie infestent presque toutes les dynamiques individuelles ; mouvement de conscience apparaissant comme le seul remède au fléau identitaire, comme la seule alternative à la violence de masse.

Deux insuffisances.
La première insuffisance suinte de mon rapport à moi : Je suis celui qui est. Autrement dit, je suis celui qui est incapable de comprendre ce qu’il est, qui ne comprend rien au fait d’être, qui est bêtement enfermé dans le piètre vertige d’une boucle, dans la trivialité nauséeuse d’une tautologie.
De la deuxième insuffisance suinte mon rapport à l’Autre : Si pour ma personne tous ses attributs se mettent plus ou moins en recul derrière l’ampleur du phénomène d’être conscient, je suis incapable de véritablement percevoir la même chose pour la personne de l’Autre. L’ampleur du phénomène d’être conscient sera, pour l’Autre, certes un peu augmentée car, partiellement accessible seulement, elle bénéficiera quelque peu d’une aura de mystère existentiel qui l’amplifiera davantage, mais elle sera surtout franchement diminuée car, accessible seulement en seconde main, uniquement par l’intermédiaire de ma propre conscience, elle pâtira grandement d’un déficit ontologique massif. L’Autre est bien plus facilement réductible que moi à ses attributs. Les diverses poulies de l’éthique, les divers cordages de l’empathie, font ce qu’ils peuvent pour le retenir, mais l’Autre est toujours et atrocement au bord de n’être que ses attributs. L’Autre est potentiellement mécanisable, moi pas, et ceci est la plus profonde différence entre le soi du moi et le soi de l’Autre, et là réside l’essence, psychologiquement, des processus pervers et, politiquement, des processus totalitaires.
L’individuité est le nom de ce qui tente, en retournant la valeur négative de la première insuffisance en valeur positive, de corriger, enfin, véritablement, durablement, la seconde insuffisance. Sous son apparence de grande sagesse, la proposition d’aimer son prochain comme soi-même relève d’une grande folie, folle parce que la finalité qu’elle projette est malheureusement trop irréelle, et n’ayant d’autre choix pour un peu exister que de se transformer en injonction, elle se fait génératrice de mal-être, et finalement de haine, et relève alors en définitive d’une incommensurable folie, folle parce que la douleur qu’elle engendre est malheureusement trop réelle. Le vivre-ensemble dans sa forme bienveillante, de tout temps, en tout lieu, ne cesse de sombrer dans l’instabilité, et cela parce que son socle toujours est chimérique et que le réel toujours travaille à reprendre ses droits. N’ayant tristement pas accès au réel, réduisons au moins le champ de la folie. L’individuité propose simplement, et simplement parce que le soi-même est le même quel que soit ses déclinaisons individuelles, de respecter son prochain comme soi-même, quel qu’il soit, quels que soient ses attributs, inconditionnellement, et de réserver le sentiment d’amour à seulement quelques interrelations privilégiées. Sous son apparence de petite sagesse, il me semble que cette proposition ne relève, et cela est salvateur, que d’une petite folie.
Regardons le « je suis celui qui est » en face, voyons qu’il n’est fatalement qu’un arrêt de la réflexion ontologique, qu’une annihilation du questionnement et donc de toute possibilité de réponse, et puis regardons-le maintenant de biais, en assumant tous les biais cognitifs : il apparaît alors comme un point de bifurcation de la réflexion ontologique, le seuil d’un chemin vers l’idée qu’il est en lui-même une réponse, vers l’idée que tout est déjà là, que le chemin est en même temps une aire de repos. Autorisons-nous à nous y installer quelque temps, et à y bâtir alors une nouvelle existentialité. « Je suis celui qui est », et cette tautologie n’osait jusqu’à présent, à part pour Dieu, qu’être une fadaise logique, et les deux verbes être qui s’y trouvent n’osaient jusqu’à présent, à part pour Dieu, que s’annuler l’un l’autre : autorisons-les, pour chaque individu conscient, à maintenant se multiplier l’un par l’autre, autorisons-nous à être à la puissance deux, autorisons le cercle tautologique à nous élever au carré, autorisons la quadrature du cercle, ayant fait le deuil de sa solution mathématique, à jouir d’une solution poétique.
Et le piètre vertige de la boucle du « Je suis celui qui est » se révèle alors être un maelström puissant qui donc ne se contente plus de circonscrire, plus ou moins puissamment, le recul de mes attributs derrière l’ampleur du phénomène d’être conscient, mais qui, par le Je défini comme un univers, carrément les engloutis dans une autre dimension, dans ma dimension empirique, laissant ma dimension ontologique indemne de tout, pure, sacrée, oui un maelström puissant qui donc ne se contente plus de circonscrire, plus ou moins artificiellement, le recul des attributs de l’Autre derrière l’ampleur du phénomène de ma conscience de sa conscience, mais qui, par le Je défini comme universel, carrément les engloutis dans une autre dimension, dans sa dimension empirique, laissant sa dimension ontologique indemne de tout, pure, sacrée. Le syntagme « Je suis celui qui est », puisque tautologique, se pose comme toujours vrai, comme infiniment vrai, et cela implique que son champ de validité ne peut souffrir d’être réduit à la seule individualité de celui qui le prononce, ne peut souffrir d’être pensé autrement que dans son infinie extension, ne peut souffrir d’encore souffrir dans l’enfermement et l’enfer de l’égoïsme. Le Je de ce syntagme n’a véritablement de sens que dans le double statut du Je individuel et du Je universel. Pour vivre mon « je suis celui qui est » dans son entière vérité, il faut que je m’approprie, outre sa perspective pointée sur ma singularité, sa perspective neutre, c’est-à-dire cette perspective qui fait que l’Autre peut se l’approprier sans le dénaturer, cette perspective qui fait que l’Autre puisse me dire « je suis celui qui est » sans que cela me semble moins vrai, cette perspective qui fait que dans une certaine mesure je suis en chacun et que chacun est en moi.
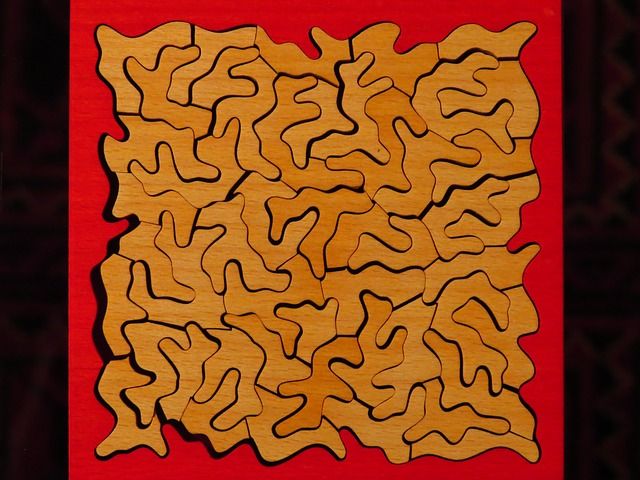
Deux mots.
Le Je était, est et sera, fatalement et à jamais, le centre de l’individu. S’acharner encore et toujours à lutter contre le Je, à tenter de détruire l’indestructible égocentrisme pour tenter de détruire l’égoïsme, est une totale absurdité. Le Nous, dans le but de se stabiliser, et de s’harmoniser, se fourvoie depuis toujours dans une logique de violence vis-à-vis de celui qu’il croit être son principal concurrent, le Je, mais taper sur le Je ne fait que le rabougrir, que donc densifier l’égoïsme - et les relations d’emprises, dans lesquelles le dominé semble oublier son égo au profit de celui du dominant, n’en sont en réalité absolument pas des contre-exemples, dans le sens où elles restructurent l’égoïsme du dominé et le réorientent vers uniquement les moyens de satisfaction personnelle qui bénéficient au dominant -, et cela fait deux perdants : le Je et le Nous. Il n’y a que sur un socle narcissique suffisamment solide que l’on peut enfin lever les yeux vers l’Autre, il n’y a qu’avec un nombril suffisamment cicatrisé que l’on peut enfin cesser de guetter sa béance, il n’y a qu’avec un gosier suffisamment étanché d’amour propre que l’on peut enfin articuler proprement de l’amour, il n’y a que sur un « Je » suffisamment bien écrit que l’on peut enfin faire tenir les mots « te respecte » ou même « t’aime ».
L’individuité est le moment où le Nous, à ce stade de la construction civilisationnelle, cesse de se fourvoyer, comprend que la dynamique égotique est la colonne vertébrale de la dynamique psychique, et se réconcilie enfin avec le Je, accepte enfin la merveille qu’il recèle et que par lui il recèle. Le syntagme « et que par lui il recèle » évidemment signifie « et que par le Je le Nous recèle », mais sa formulation était volontairement ambiguë pour laisser la place à la signification « et que par le Nous le Je recèle de surcroît », toute réconciliation ne pouvant avoir de sens que dans les deux sens. L’individuité définit pour chacun un égocentrisme si vaste qu’il inclut en lui tous les égos, définit un Je à la dimension de l’universalisme, définit une respiration si large que l’égoïsme, alors privé d’air, n’inspire plus que ses propres expirations et finit par expirer, définit l’altruisme non plus sur le mode du sacrifice mais sur celui, bien plus efficient existentiellement et socialement, du méta-narcissisme, définit un positionnement existentiel où l’empathie fait du soi un univers foisonnant de multiples soi et de soi un être plus vivant, pour qu’enfin, à sa véritable mesure, le soi soit. Le Je était, est et sera, fatalement et à jamais, le centre de l’univers.
La solidarité et la fraternité, lorsqu’elles s’inscrivent dans une dynamique identitaire, sont parmi les leviers d’une affreuse machine qui pompe douloureusement le cœur des individus pour remplir le cœur du groupe identitaire qui, en tant qu’entité symbolique, en tant qu’architecture sans substance, en tant que chimère dont la chair sacrée n’est faite que de l’absurde croyance en sa chair sacrée, n’a pas de cœur, juste un gouffre sans fond, qui donc jamais ne se remplit, mais qui en demande toujours plus, jusqu’au sacrifice ultime de chacun.
L’individuité est le bruit que fait la destruction de cette affreuse machine…
La solidarité et la fraternité, lorsqu’elles s’inscrivent dans une dynamique phénoménale, sont parmi les leviers d’une magnifique machine qui aspire délicieusement le cœur des individus pour, à travers les mécanismes potentialisants des groupes phénoménaux, remplir de façon démultipliée le cœur des individus.
L’individuité est la musique que fait cette magnifique machine lorsque l’humanité y souffle dedans…

Nos vies appartiennent depuis toujours à nos communautés, aux dieux qu’elles sont et qu’elles font… Et puis, bouleversement incommensurable, voilà que peu à peu nos vies nous appartiennent…
Que faire avec ça sur les bras, notre vie, notre propre vie ?
La liberté peu à peu remplace la violence… Alors, stupeur incommensurable, le monde réalise qu’il est surentrainé dans la gestion de la violence, mais totalement novice dans celle de la liberté…
En quoi consiste, au juste, le travail d’un dieu ? Peut-être à comprendre qu’exister n’est pas un travail…
Le problème avec les groupes identitaires, c’est qu’ils sont plusieurs. D’où les inégalités par blocs, les égoïsmes collectifs, les perversités de masse. D’où les guerres.
La richesse civilisationnelle peut s’évaluer autant par la multiplicité des groupes phénoménaux que par la rareté des groupes identitaires : lorsqu’il n’en restera plus qu’un, l’humanité elle-même, il n’en restera plus, un sera égal à zéro, et ce non-sens mathématique illustrera le non-sens de l’identitaire, et la fortune civilisationnelle sera là. Bien sûr il faudra encore faire fructifier cette fortune, mais au moins la misère des oppositions arbitraires sera dépassée.
S’imaginer tuer symboliquement ou physiquement quelqu’un est si simple, et s’imaginer se faire tuer symboliquement ou physiquement par quelqu’un est si difficile, et cet écart est si fondamental que toute réflexion sur l’éthique doit impérativement, sous peine de ne jamais advenir, inclure en elle cet écart, le vide spirituel de cet écart, et doit impérativement, sous peine de ne jamais rien faire advenir, elle-même s’inclure en cet écart, pour essayer de le combler, combler cette plaie, et ainsi essayer de faire se rapprocher les berges du respect à soi et du respect à l’Autre, jusqu’à se toucher, et ainsi essayer de cicatriser la chair depuis toujours blessée de l’humanité.
L’individu conscient est par définition égocentré. Voir cela, sa réalité psychique, comme une faute, comme un péché originel, est une aberration, une douloureuse aberration. Le péché originel commun à toutes les morales est de s’être chacune inventé un péché originel. Condamner le réel et s’acharner à le nier nous ôte toute chance de le modifier, il faut au contraire s’y inscrire pleinement, le et donc se comprendre en profondeur, pour avoir une chance de faire émerger, à partir de l’être, du bien-être. La morale doit laisser la place à l’éthique, et l’éthique doit laisser une large place, en son centre, à l’égo.
Non, je formule mal les choses, il ne s’agira pas que de laisser une place, quand bien même elle serait large, quand bien même elle serait centrale. Mieux vaut formuler que, comme, du cerveau, l’esprit, l’éthique devra dorénavant être conceptualisée comme une propriété émergente de l’égo.
Ni le bien ni le mal, au fond, ne motivent le comportement, seul l’ego et sa faim insatiable nous pousse dans l’une ou l’autre direction, selon celle qui le nourrira le mieux. La générosité n’est pas moins égotique que l’égoïsme, la perversité n’est pas plus égotique que la bienveillance. Les saints et les salauds n’existent pas, seuls existent des circonstances, des actes, et des individus qui gèrent leurs esprits comme ils peuvent, qui du risque constant de famine sauvent leur égo comme ils peuvent. Comme ils peuvent avec ce qu’ils ont, avec ce qu’ils sont. Croire en la bonté de l’humain est aussi naïf que de croire en sa malveillance. L’humain est profond, mais les notions de bien et de mal, à cause du décentrement hors de l’égo qui trop longtemps a ordonnancé leur dynamique sémantique, sont demeurées superficielles, incapables de rejoindre véritablement l’humain.
La morale est structurée sur le sacrifice de soi. L’injonction de donner quelque chose au dieu qu’est, ou aux dieux de, sa collectivité est indissociable de celle de se retirer quelque chose à soi, au pire sa propre vie. Il s’agit là d’un système représentationnel délétère, mortifère, forcément autoritaire, qui ne perdure que par la glorification forcée, factice, stupide, de l’esprit de sacrifice. Mais peu à peu ce qui est forcé perd ses forces, la facticité se désagrège, la stupidité renonce, peu à peu l’individuité avance, la collectivité perd de sa, et perd ses, sacralité(s), les individus gagnent en sacralité, et la perspective de sacrifier les uns ou les autres ou tous ou soi, partiellement ou totalement, devient alors de plus en plus insupportable. L’éthique, elle, ne voulant pas nier notre consubstantielle égotisme, est structurée sur le sacrifice total de la notion de sacrifice.
Aucune harmonie du vivre-ensemble ne s’est jamais établie avec la morale sacrificielle, c’est-à-dire dans un cadre injonctionnel où chacun est en lutte avec la collectivité et en lutte avec lui-même, c’est-à-dire dans un cadre injonctionnel dont le sol n’est fait que de la brûlure des pieds et les murs que de l’empêchement des mouvements et le plafond que de l’écrasement des crânes, non, aucune harmonie, seule la fièvre en vérité s’y est établie, la fièvre identitaire, une fièvre chronique, qui dure parce qu’elle est piégée dans son cercle vicieux, le sacrifice entrainant le sacrifice, une fièvre qui fait délirer, gravement délirer, et qui fait notamment croire qu’il n’y a là nul délire et que cette fièvre n’est que la chaleur fraternelle issue de l’harmonie du vivre-ensemble déjà établie depuis toujours.
Brider l’individu au nom du bien-être collectif, au nom d’un système, le collectif, qui, en tant que système, ne peut ressentir de bien-être, au nom d’un système, le collectif, composé alors d’individus bridés, revient à indéfiniment perpétuer le mal-être collectif en se trompant sur son nom. L’éducation, lorsqu’elle penche du côté de la morale, est une castration destinée à emboiter facilement, sans rien qui dépasse, l’individu dans les valeurs de sa collectivité, et lorsqu’elle penche du côté de l’éthique, est le façonnage du sentiment de gratification narcissique destiné à le faire s’emboiter facilement, avec chaque fois sa singularité, dans le sentiment du respect à l’individu.
Prenons l’exemple de l’impôt dans les démocraties. Il est moral de payer ses impôts. Cela correspond au déplaisir d’arracher de l’argent à son compte en banque pour l’abandonner à la collectivité, et toutes les magouilles sont alors bonnes pour éviter cela, et toutes les colères alors légitimes lorsque les sommes réclamées augmentent. La castration a ses limites. Mais il est aussi éthique de payer ses impôts. Et cela correspond au plaisir de se payer le fait de vivre dans une collectivité disposant, par la redistribution, d’un bon niveau de respect aux individus. Et toutes les magouilles et toutes les colères disparaissent alors dans leur inanité. Le respect aux individus, et donc au soi, et donc à soi, n’a pas de limites…
Donner à autrui c’est donner au soi, donner à ce dieu, le soi, dont je suis l’une des incarnations, c’est donc indirectement, et même finalement directement, me donner à moi. Le gain n’est pas que psychologique (la jouissance de s’inscrire dans la puissance de l’éthique) ou sociologique (les bénéfices du système vertueux auquel l’on participe), il est également ontologique (la ressource de se redéfinir selon un soi plus large que le simple moi). Être capable de penser que ce qui nuit à autrui nuit au soi et donc à moi, être capable de penser l’éthique selon notre réalité égotique, est la seule façon de la rendre capable d’agir sur notre réalité égotique. Le devoir, moteur de la morale, ne mène qu’au devoir de la morale, mais l’empathie, moteur de l’éthique, cette capacité à se mettre à la place de l’Autre, cette capacité à penser l’Autre selon la plasticité offerte par le soi et cette capacité à penser le soi selon la multiplicité offerte par l’Autre, mène à l’innovation et à la prolifération des droits et au droit d’être qui l’on est, du moins qui l’on veut être.
Si je devais choisir entre ma vie et l’éthique, je choisirais très probablement ma vie, je choisirais mon ego, pour la simple raison que le « je » du « je choisirais » est déjà en lui-même le résultat du choix et qu’il est extrêmement difficile de le contredire, je choisirais mon ego pour la simple raison qu’être conscient c’est être un égo, qu’il n’y a en réalité pas le choix. L’un des sens du progrès est celui de la construction d’un monde dans lequel les situations imposant ce genre d’alternative n’existeraient plus. Lorsque je dois choisir entre le non éthique et l’éthique, je choisis très souvent l’éthique, parce qu’encore et toujours je choisis ma vie, je choisis mon ego, je choisis, à la place du médiocre gonflement égotique qu’offre parfois certaines sirènes du non éthique, la véritable amplitude et finalement plénitude égotique qu’offre presque systématiquement l’éthique.
Stéphane Sangral
recension de son dernier bouquin "Préface" par Patrick Schindler
Compte-rendu d’une discussion à Publico par Schindler Patrick
Interview par... Patrick Schindler
PAR : Stéphane Sangral
Réagir à cet article
Écrire un commentaire ...
Poster le commentaire
Annuler




