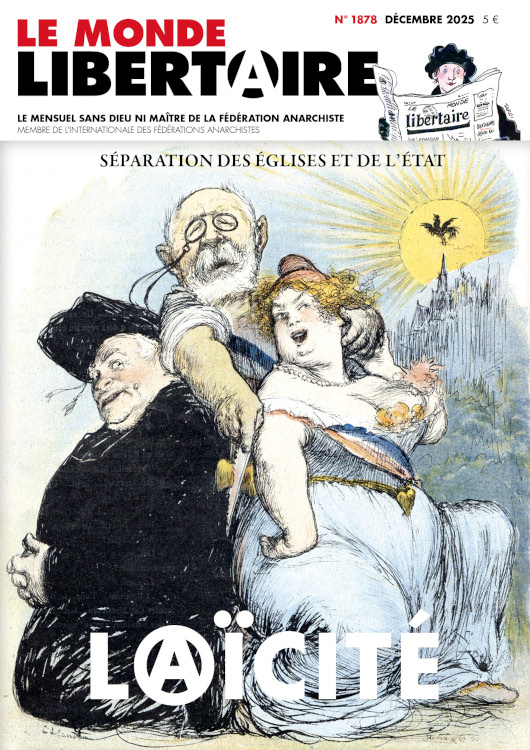En octobre le rat noir lira-t-il des octosyllales à l’octopode octogénaire ?

Clin d’œil grec pour entamer ce mois d’octobre avec La révolte des Caryatides, le dernier polar de Pétros Markaris. Petit saut aux États-Unis : Mon chien stupide de John Dante. Espagne : Confiteor de Jaume Cabré. Belgique : Le bel obscur de Caroline Lamarche. France : redécouverte de Tous les chevaux du roi de Michèle Bernstein et pour le 80ᵉ anniversaire du procès de Nuremberg : Les anarchistes et le devoir de mémoire de Pierre Sommermeyer.

« Si des marins sur l’eau voient s’avancer les ports, Mes dormeurs vont s’enfuir vers une autre Amérique. »
Jean Genet, Le condamné à mort
Pétros Markaris : La Révolte des Caryatides
.jpg)
Nous y retrouvons son héros, Kostas Charitos, ancien chef de la brigade criminelle d’Athènes, à la veille de sa nomination par le ministre de l’Intérieur, au poste de directeur de la sûreté de l’Attique. Une femme est désignée pour le remplacer à son ancien poste, « ce qui fait l’effet d’une bombe au sein d’une corporation on ne peut plus machiste ». Stupeur générale. Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Charitas est interpellé par une émission de la télé d’État qui annonce qu’après avoir sombré dans la crise, avoir reçu le pactole de l’UE et après le covid, la Grèce est « censée se diriger vers la croissance »…
Et dans la foulée, les journalistes révèlent le projet d’entrepreneurs étrangers qui, vu le contexte géopolitique, non seulement souhaitent déplacer leurs entreprises dans un pays « lointain et isolé », mais ont aussi l’ambition de construire un nouveau complexe touristique « sur le modèle de l’ancienne cité antique », en commençant par édifier une nouvelle marina au Cap Sounion.
Ceci faisait diablement penser au projet réel de Mitsotakis de construire un Centre commercial international de luxe, sur l’ancien site de l’aéroport Eliniko d’Athènes, dont les travaux ont déjà commencé à défigurer le littoral athénien.
Mais les investisseurs étasuniens ici, envisagent également d’ouvrir un train touristique où « grâce à l’Intelligence Artificielle, ils pourront « non seulement visiter sans y aller les sites historiques, mais aussi voyager en compagnie de Grecs anciens ». Concept qu’il pourrait pareillement transposer dans l’espace !
La femme de Charitos, beaucoup plus terre-à-terre que son mari et à l’humour ravageur, est, elle, persuadée que vu le caractère intègre de son mari, il ne se fera pas acheter dans son nouveau job (qui consiste à assurer la sécurité des entrepreneurs) par des pots-de-vin. Le lendemain, nous suivons le nouveau chef de la sûreté en réunion d’urgence : les manifestations anti-projet promettant d’être agitées par des manifestants reprenant le thème : « Les étrangers reviennent nous voler nos antiquités. Nous ne sommes pas à vendre ! ».
Et en effet, les réactions ne tardent pas à arriver. Dès le lendemain de l’émission télévisée, des toiles noires recouvrent le temple de Poséidon au Cap Sounion. Dans Athènes, un groupe de féministes baptisé Les Caryatides rappelle lui, que « les féminicides qui étaient communs dans l’Antiquité n’ont jamais cessés et que bien au contraire dans le monde actuel, il n’est pas questions qu’avec cette nouvelle invasion de pirates, ils ne doivent pas passer au second plan » ! Elles appellent donc à se soulever contre le projet et à combattre à leurs côtés.
Les réactions dans la population sont moins tranchées : 50% des uns se déchainent contre les étrangers et les 50 autres - dont un archéologue hyper-agressif – prennent pour cible les Caryatides. Or, peu après ces deux événements, un des dix investisseurs disparait mystérieusement… Les services de la sécurité sur les dents, visent déjà les anarchistes et des terroristes potentiels. Charitas est plus circonspect. D’autant que l’affaire rebondie lorsqu’une des féministes est retrouvée poignardée.
Comment va réagir alors l’opinion publique ? Dès lors, nous allons vivre l’enquête aux côtés de Charitas et de la nouvelle cheffe de la brigade criminelle, particulièrement intuitive et efficace. Cette dernière est vite adoptée dans la famille de Charitas, très caractéristique dont nous suivrons parallèlement la vie au jour le jour.
John Fante : Mon chien stupide
.jpg)
John Fante (le père de Dan) est né en 1909 à Denver (Colorado). Fils d’immigrants italiens, ce gamin des rues découvrira dans une école jésuite, son besoin de liberté, de sexualité et d’écriture. Mais il échoue dans ses études universitaires. Il commence très tôt à écrire, inspiré par Knut Hamsun (voir le Rat noir d’août), Dostoïevski, Jack London et Sinclair Lewis. A Los Angeles, il exerce de nombreux petits métiers pour survivre. Ses livres ont souvent une trace autobiographique mais que John Fante n’hésite pas à améliorer « pour lui donner plus de substance, plus de goût, plus de puissance » !
.jpg)
Le couple n’a plus alors qu’une obsession : s’en débarrasser. Mais avant cela, nous allons faire la connaissance du reste de la famille. Accrochez-vous bien ! Tout d’abord l’ainé de la fratrie, Dominic, toujours entre deux effluves de Marijuana, et leur fille Tina, « l’emmerdeuse » et son fiancé Dick, ancien sergent dans la marine, homophobe « se comportant comme un goujat avec ma fille et comme un goujat avec moi » ! Denny, le cadet, étudiant en théâtre. Celui-ci faisant faire sa thèse par sa mère (!) et enfin, Jamie, le benjamin de la fratrie (19 ans) « l’innocent aux mains pleines », le préféré de ses parents et qui a baptisé « le chien-ours pédé », Stupide. Mais pourquoi Stupide, ce bâtard, a choisi cette famille de fous alcooliques et racistes pour semer la pagaille dans ce quartier de WASP, tandis que notre héros devenu familier ne rêvait, lui, que de quitter sa famille et être heureux ? Or, il n’a pas fini d’en baver avec Stupide, d’ailleurs tout comme « le monarque canin du coin, un affreux cleps de race baptisé Rommel » ! Ce petit roman est un exemple de mauvais goût au sein d’une Amérique hyper-coincée et ne peut que nous faire penser qu’à l’atmosphère toute aussi désuète des films de John Waters …
Jaume Cabré : Confiteor
Jaume Cabré, licencié de philologie catalane, a combiné pendant de nombreuses années l’écriture et l’enseignement. Il a également travaillé à l’écriture de scénarios. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands écrivains de Catalogne..jpg)
Confiteor (Je confesse, en latin) de Jaume Cabré (éd. Actes Sud, traduit du catalan par Edmond Raillard), commence sur cet aveu : « Ce n’est qu’hier soir tandis que je marchais dans les rues trempées de Vallarca, que j’ai compris que naitre dans cette famille a été une erreur impardonnable. Tout à coup, j’ai vu clairement que j’avais toujours été seul. Mes succès et mes erreurs sont de ma responsabilité. Il m’a fallu soixante ans pour voir ça. Je demeure sans croyances, sans prêtres, sans codes consensuels pour m’aplanir le terrain où je suis ».
Ainsi s’ouvre le journal d’Adria que notre héros adresse à une seule personne, une certaine Sara. Nous sommes projetés dans les années 1950. Adria n’est alors encore qu’un gamin en culottes courtes vivant dans un grand appartement, entre son père Felix, collectionneur d’objets et manuscrits rares. Volage, peu affectueux et toujours entre deux voyages d’affaires. « Lorsqu’il entrait dans son bureau, Adria avait alors interdiction formelle de toucher quoi que ce soit et devait garder les mains dans les poches ». Carme, sa mère, une femme distante n’avait qu’un seul fantasme : que son fils devienne un violoniste virtuose. Le reste de son éducation était confiée à Lola Xica, sa fidèle nourrice, « sa seconde mère ».
Dès les premiers chapitres, il va falloir nous habituer à faire de nombreux aller-retours entre le présent, le passé et le futur. Ainsi, nous voici projetés en 1690, l’année d’un terrible incendie dans une forêt italienne de la région de Crémone. Puis, trois décennies plus tard à Ostie, sur les traces du père d’Adria promis dans un premier temps, à une carrière religieuse qui ne durera guère. Nous découvrirons également le passé de sa mère, élevée seule par son père durant la proclamation de la Troisième république catalane. Evoquant ces souvenirs, Adria s’interroge sur ce drôle de couple « Je me demande pourquoi ils s’étaient mariés. Je crois qu’ils ne se sont jamais aimés. A la maison, il n’y eut jamais d’amour. Et moi, je n’ai été qu’une pure conséquence circonstancielle de leur vie. La mienne était un éternel crépuscule et moi j’étais un enfant très bizarre qui espionnais tout dans la maison avec mes fidèles compagnons figurines, le shérif Carson et le vaillant chef indien Arapaho, que j’avais appelé Aigle Noir. Je les consultais sans cesse et ils me prodiguaient toujours de bons conseils ».
Très tôt malgré son caractère indécis et sa tendance à tout mélanger, Adria devient la grande fierté de son père : il est un élève érudit maitrisant rapidement nombre de langues étrangères qu’il apprend très jeune sans aucune difficulté. Son seul abri hors de chez ses parents : la boutique paternelle, mais certainement pas dans l’école de Jésuites où son père, malgré son athéisme, l’avait inscrit sans lui demander son avis. Nouveau retour en arrière sur l’Inquisition mais aussi aux côtés du célèbre luthier Storioni de Crémone en 1764, ce qui ne sera pas sans importance pour la suite du récit. En effet, à partir de la mort de son père, Adria va se sentir responsable d’une des œuvres de Storioni parvenu mystérieusement entre les mains paternelles et faisant l’admiration de son seul ami, Bernat, son double « De temps à autre, il nous arrivait d’avoir des disputes comme si nous étions des amants désespérés ». Bernat qu’il a connu durant ses cours particuliers de violon. Ce dernier particulièrement doué pour l’instrument, mais nul en littérature à l’inverse d’Adria.
Bernat dont la femme dira plus loin : « Personne ne sait qu’il écrit, pas même son éditeur, tu comprends : c’est de la merde ce qu’il écrit » !...
Les années passant, à la mort du paternel, que deviendra le magasin d’objets d’arts et plus particulièrement, le précieux violon ? Sa mère si distante, continuera-t-elle à garder pour elle ses secrets ? Et pour quelles raisons obscures, le terrible commissaire franquiste Plasencia enquêtera-t-il sur les conditions de la mort du père, probablement assassiné ? C’est lors d’un voyage d’Adria à Paris que nous allons enfin faire la connaissance de la fameuse Sara à laquelle est dédié son journal. Sara, « l’amour impossible de sa vie » ! A ce sujet, il nous faut souligner que dans ses dialogues, Jaume Cabré n’est jamais avare de termes parfois très crus. Nous continuerons donc à suivre l’ascension de Bernat devenu virtuose et celle d’Adria, devenu écrivain à succès qui, après avoir consacré un ouvrage à « l’histoire de la Culture » envisagera de compléter sa démarche avec une ultime « histoire du mal ». Le beau, puis le mal, donc. Ces deux extrêmes qui nous vaudront autant de références culturelles et historiques captivantes.
Nous revivrons donc entre autres, les années noires de la dictature tandis que l’antisémitisme montait en Catalogne et remontrons lors des multiples aventures de Felix, le père d’Adria, les heures « où l’Allemagne et les pays limitrophes puaient le nazisme » et atteindront leur paroxysme avec les horreurs pratiquées dans les cabinets de recherche médicale du camp d’Auschwitz-Birkenau « où la vie était parfois pire que la mort ». Mais outre les perpétuels allers-retours dans la psychologie spéciale d’Adria et dans les tréfonds parfois les plus nauséeux de l’histoire, nous finirons par nous familiariser avec l’utilisation par le héros-narrateur, parfois du « je » et d’autres fois du « il », formant au final un tout on ne peut plus cohérent et très puissant.
Michèle Bernstein : Tous les chevaux du roi
.jpg)
Dans l’avertissement de Tous les chevaux du roi, un petit volume paru en 1960, et réédité par les éditions Allia, Michèle Bernstein nous explique pourquoi en le redécouvrant, elle s’est rappelé « avoir écrit ce roman "à l’eau de rose", pastiche du style de Françoise Sagan, afin d’être certaine d’être éditée : J’allais fabriquer un faux roman à la mode, mais le farcir d’assez d’indices et d’ironie pour que le lecteur moyennement perspicace s’aperçoive qu’il y avait là comme une plaisanterie, une critique du roman lui-même, très vulgairement, cela s’appelle "au second degré" ». Il convient d’ajouter à ceci que, malgré les deux textes présentés sur la 4ème de couv et écrits par Michèle Bernstein et Guy Debord, « personne ne semblait comprendre ces criantes clés, sauf le regretté Pierre Dumayet qui m’avait invité dans son émission Lectures pour tous, mais je m’abstins d’y dire la vérité » !
« J’aime les gens gais, qui n’ont pas d’histoires »
Sans ces précisions préalables, il est fort à parier que tout lecteur se serait de même aujourd’hui laissé piéger, tandis que l’action de ce petit roman débute dans une galerie de St Germain-des-prés lors d’un vernissage. Un couple d’environ vingt-cinq ans d’âge, Geneviève, la narratrice et Gilles, son compagnon, « un homme qui passait son temps à disparaitre et réapparaitre », s’intéressent à Carole (20 ans), la fille du peintre qui fait un bide ce jour-là. « Tu l’aimes demandais-je à Gilles. Il fit oui de la tête. J’eus la même réponse positive. C’était normal car si Gilles n’avait pas aimé la même fille que moi, cela eût introduit entre nous un élément de séparation ». Geneviève connaissant Gilles depuis trois ans, elle n’est pas jalouse : « le climat qu’il recréait partout était fait de cette sincérité de sentiment et d’une conscience aiguë du côté tragiquement passager des choses de l’amour. J’étais une exception, j’étais donc à l’abri ». Mais les choses se compliquent un peu lorsque Geneviève fait connaissance à son tour du jeune Bertrand, 19 ans, poète en herbe, « gauche et beau gosse », car l’été venu, tout ce petit monde et Hélène, la première petite amie vieillissante de Bertrand, se retrouvent tous ensemble à Saint-Paul-de-Vence dans le Midi de la France. Tandis qu’Hélène pour un temps tient l’harmonie du petit groupe, que restera-t-il de tout cela après la saison des amours de vacances ? Une expérience de plus ? Quelques réflexions philosophiques ? A découvrir.
Caroline Lamarche : Le bel obscur

.jpg)
Et pourquoi ces cinq dates semblent être « le reflet d’une vie brisée et rythmée par le malheur - mis à part la citation d’un acte héroïque qu’a accompli jeune homme » ? Edmond était-il un chlemil (être qui porte la poisse en yiddish), au point d’être effacé de l’arbre généalogique ? Edmond le Damnatio memoriae ?!...
C’est à partir de ce moment-là que notre narratrice fait le lien entre Edmond et son ex-mari Vincent qui lui aussi, avait tenté de sauver un couple de la noyade, soit « une formidable synchronicité », selon le terme de Jung. « Vincent, l’homme de ma vie, d’une beauté rare pour une fille banale comme moi, un amour que je me refuse d’oublier, d’ailleurs, ne dit-on pas que les perles meurent si on ne les porte pas ? … »…
Mais plus elle avance dans ce qui devient une véritable enquête sur Edmond, avec parcours obligé via des spécialistes des thèmes astraux, en graphologie et même un médium (« Pourquoi pas, Victor Hugo et Jules Vernes étaient bien passés par là ! »), plus le rapprochement avec Vincent devient probant. Du moins, le Vincent que son mari est devenu après lui avoir révélé son amour des garçons. « Nous ne nous mentions jamais et ce que j’acceptais pour essayer de comprendre notamment la légèreté avec laquelle il m’avait purement et simplement larguée, moi et nos deux filles ».
C’est donc deux vies que nous allons suivre à présent simultanément. Celle d’Edmond, jusqu’à ce qu’il soit retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Orléans (suicide, drogue ?) et celle de Vincent, grâce à la relecture des journaux de la narratrice, tout en nuances, pour y découvrir les signes avant-coureurs de leur séparation. Le récit gagne en profondeur par la juxtaposition de ces deux destins, renforcé par des références bienvenues à Virginia Woolf, Guillaume Apollinaire, Stefan Zweig, Léon Tolstoï, Oscar Wilde, Simone de Beauvoir, Jérôme Bosch, Marguerite Duras et Yann Andréa, Magnus Hirschfeld et bien d’autres.
Pierre Sommermayer : Les anarchistes et le devoir de mémoire
.jpg)
« Ne pas baisser les bras, certes, mais surtout ne pas se laisser emporter par les torrents de merde. Je suis obsédé par la nécessité de laisser des traces comme les anciens l’ont fait et qui nous ont nourri »...
Pierre Sommermeyer
Dans le prologue de Les Anarchistes et le devoir de mémoire, Auschwitz, Nuremberg, 80 ans après (éd. Du Monde libertaire), un éditorial du Monde libertaire datant de 2005, pose cette question pertinente : « En cette période de commémoration de la Shoah, que peuvent faire les anarchistes ? ».
Vingt ans plus tard, Pierre Sommermeyer - né en 1942 de parents allemands antifascistes émigrés en France, objecteur de conscience non-violent pendant la guerre d’Algérie - réveille nos consciences : « tandis que les trompettes sonnent de nouveau, la Shoah ne va-t-elle pas devenir un succès de librairie et attirer les foules vers les cinémas. Mais la fiction des romans et des images peuvent-ils faire ressentir plus que les chiffres, la réalité de ce qui s’est passé ? ». Aussi l’auteur de ce petit recueil décide d’en revenir aux fondamentaux posés par ces questions, pour essayer de trouver une réponse en se penchant sur les articles parus dans le Monde libertaire, traitant de l’ensemble de la problématique.
Premier arrêt en France, avec le SG de la préfecture de Gironde sous Vichy : Maurice Papon, dont le procès, tandis qu’il était âgé de 88 ans, dura plus de cinq mois. Une bonne occasion de plonger dans les eaux troubles du révisionnisme, de la « non-responsabilité » de l’individu, revendiquée par ses avocats, « suppôts de l’extrême-droite ou carrément de la négation de la Shoah », avant le verdict. Mais, se demande une première fois Pierre Sommermeyer, quid de la mémoire des victimes, à travers les comptes-rendus de ces articles dans le Monde libertaire ? A travers cet exemple, il nous invite alors à réfléchir avec JM Traimond, sur le manque de précision de la presse anarchiste quant à la « responsabilité ». A découvrir.
Petit arrêt sur l’épisode, peu connu, du camp de concentration du Struthof dans lequel sont passés de 1945 à 46, des Alsaciens et Allemands civils (principalement des enfants), soupçonnés de collaboration, sans jugement (source : Mairie d’Urmatt, 2025). Le point abordé ensuite est issu d’une interview que Patrick Schindler avait faite de Claire Auzias à la sortie de son livre Samudaripen, le génocide des Tziganes. Celle-ci appuyait sur le fait que le génocide nazi ne concernait pas « que » le peuple juif, ce que nous constaterons en relisant l’histoire insoutenable de leur persécution, depuis la loi de 1912 à leur internement dans les camps français de Vichy, avant d’être envoyés aux camps de la mort nazis, pour y subir « un traitement spécial en tant que peuple qui n’existait pas » ! Plus loin, Jimma, Hélène Hernandez et Monica Gruszka reviendront en détail sur le sort réservé dans les camps français, aux Républicains espagnols de la Retirada et spécifiquement celui des femmes, avant et après l’armistice. Ce chapitre s’achevant sur un extrait du livre Parias : Hannah Arendt et la tribu en France (éd. L’Echappée), voir le Rat noir d’août 2025.
Le chapitre suivant s’ouvre sur le livre de Thierry Guilabert Les ruines d’Auschwitz ou la journée d’Alexander Tanaroff.
L’auteur nous explique pour quelles raisons il s’est rendu à Auschwitz sur les traces de Tanaroff et Pierre Sommermeyer celles pour lesquelles lui n’a jamais voulu se rendre à Auschwitz. Pour ce faire, il part de la publication de La France juive d’Edouard Drumont en 1886, en passant par la réunion de Wannsee, « où 15 hommes mirent au point en 1935, la solution finale qu’ils ont eu le culot de qualifier de "propre" » !
Pierre revient ensuite sur le terme de « banalité du mal », employé par Arendt à propos d’Eichmann et qui souleva une telle polémique mondiale. Il revient également sur Les désobéissants du Chambon sur Lignon, un lieu de mémoire dans le Vivarais, destiné à présenter les opérations de sauvetage menées par ses habitants au cours de la Seconde Guerre mondiale et « qui dérange tout le monde »…
Un nommé Caillou reprend le flambeau dans le Monde libertaire, en poussant très loin la réflexion sur le sens à donner aux commémorations, y compris celle des anarchistes au Mur des Fédérés de la Commune !
Plus loin, Pierre Sommermeyer évoque le procès de Nuremberg ouvert en novembre 1945, et nous propose de le vivre à travers les articles parus à l’époque dans la presse libertaire. Articles qui nous laisseront songeurs. Pierre de se demander pourquoi cette dernière restait focalisée sur le procès et surtout « pourquoi ce fut le concept de crime contre l’humanité qui prévalu sur celui de génocide, pourtant au cœur du projet national-socialiste » ? Pourquoi un tel silence dans la presse anarchiste ? Nous suivrons ensuite le procès Eichmann, lui peu évoqué dans la presse libertaire et serons effarés une fois de plus par ce qu’en dirent les révisionnistes, notamment un de ses fondateurs, un certain Paul Rassigner, ceci faisant un lien avec le chapitre suivant qui évoque les libertaires face au négationnisme.
A commencer par le cas LF Céline. Là encore, nous y lirons un peu tout et n’importe quoi, les propos surprenants de certains intellectuels, heureusement compensés par des oppositions radicales, venant de Benjamin Perret et Albert Camus.
Une fois encore Pierre Sommermeyer s’indigne : « mais où sont passés dans tout ce fatras, les Juifs exterminés ? » Ensuite, Félix Boutal fait un rappel, très utile, sur ce en quoi consiste exactement le négationnisme, le relativisme et le révisionnisme. On y retrouve évidemment Paul Rassinier et son adhésion opportuniste au mouvement libertaire avant d’en être exclu, « mais non sans mal ». A qui en incombent les responsabilités, alors ? Emboiteront le pas à Rassinier, les sinistres Garaudy et Faurisson et une partie de l’extrême gauche française. Nous verrons pourquoi Félix Boulal finit pourtant par conclure de ce triste rappel :« Laisser penser cependant que l’anarchisme est perméable au négationnisme est une insulte à son histoire »…
Cettia Cetti part, elle, du livre Zygmunt Bauman Modernité et Holocauste (éd. La Fabrique) qui récuse systématiquement l’attitude de la simple commémoration de la Shoah, insistant sur le fait que « celle-ci ne pouvait se produire que dans et par une société moderne industrielle », transposant la situation dans notre monde actuel, à l’appui d’un exemple personnel et troublant qu’elle a vécu à la poste, à la SNCF ou encore, au Service des objets trouvés ! Confondant.
Pierre Sommermeyer s’interroge ensuite, sur les récits de guerre et de génocides, « jouant un rôle important dans la fabrication du consensus social et culturel » et donne l’exemple d’un livre qui remet en cause cet état de fait comme, La Séduction du bourreau de Charlotte Lacoste. Il revient ensuite sur l’interview d’Hannah Arendt, ouvrant la voix sur la spécificité de la Shoah par rapport aux autres génocides (Cambodge, Rwanda, etc.). Sans pour autant oublier l’attitude des « nouveaux révisionnistes », prenant le prétexte de l’autoritarisme d’Etat d’Israël envers les palestiniens « pour tenter de faire passer la Shoah pour un massacre comme un autre ».
Ce petit livre s’achève sur une motion de la Fédération anarchiste appelant à combattre tout antisémitisme et à bien le dissocier de l’antisionisme « tout en traitant le nationalisme de l’Etat d’Israël de la même façon que n’importe quel Etat nationaliste » !
En guise de conclusion, Pierre Sommermeyer se demande pourquoi les faits historiques ne suffisent pas en tant que tel, face aux œuvres qui depuis 1945, évoquent la Shoah et la raison pour laquelle on doive faire régulièrement des piqures de rappel, surtout face à ce qui se passe de nos jours en Cisjordanie ? Il tente d’aborder sous l’angle personnel, les nombreuses et complexes réponses qui nous sont proposées devant l’inconcevable (dont celle de la Cour Pénale internationale). Merci à toi, Pierre : enfin un ouvrage qui pose les vraies questions face « à la montée de l’illébéralisme pré fascisant en occident », selon ta propre expression et aux devoirs de mémoire qui s’imposent. Et pour terminer, pourquoi refuser d’admettre que les anarchistes ne sont pas si différents des autres en la matière ?!
Patrick Schindler, groupe de Rouen de la FA
Un passager clandestin ou comment Boris Vian, par une berceuse pataphysique à récapitulation, rappelle qu’à Paris la Gestapo française sévissait, rue Lauriston.
Autre passager clandestin, un texte nous invitant à nous rappeler de demain, ou quand Djamel Allam emprunte la voie Ferré.
Groupe de Rouen
"Qu’on me laisse à mes souvenirs de lecture" fredonne le rat noir en ce mois de novembre.
Septembre, des livres plein le cartable, le rat noir fait sa rentrée
Qui est in et qui est août ? se demande le rat noir
Juillet, rat noir, qu’est-ce que tu lis pour les vacances ?
Le Rat noir a lu Guy Pique
Mai, ou, et, donc, le rat noir ?
C’est le printemps, avril, le rat noir est de retour.
Sur le calendrier du rat noir, au mois de février, les jours s’allongent peu à peu
"Monsieur Janvier, c’est des livres francs" exige le rat noir.
Décembre, le rat noir a rempli sa hotte
A Athènes, Exarcheia est toujours bien vivante : La Zone, un nouveau lieu de rencontre libertaire vient d’ouvrir ses portes !
Le rat noir fera craquer les pages blanches, octobre tiendra sa revanche
Les livres portent déjà les couleurs de septembre et l’on entend, au loin, s’annoncer le rat noir
Le raout du rat (noir) en août
Les livres du rat noir de juin, les livres du rat noir de juin
Mai, mai, mai, Patrick mai... Mai, mai, mai, rat noir !
"Nous roulerons comme les écrivains roulent Ni riches, ni fauchés... Viens être mon rat noir d’avril Viens, nous allons briser toutes les règles"
Mars : "Un pas, une pierre, un rat noir qui bouquine..."
Février de cette année-là (2024) avec le rat noir
Janvier, une nouvelle révolution... terrestre*. Et le rat noir, toujours là.
Décembre : pas d’hibernation pour le rat noir.
Novembre, le rat noir toujours plongé dans des livres.
lectures d’octobre avec le rat noir
Sœurs ensemble, tu n’es plus seule !
Les vendanges du rat noir. Septembre 2023, un bon cru...
Le rat noir est "in" pour ce mois d’août
Lunettes noires pour un rat noir, voilà juillet.
Gay Pride d’Athènes 2023 en une seule photo !
Le rat noir répond à l’appel de juin
En mai le rat noir lit ce qui lui plait (mai 2023)
En avril le rat noir ne se découvre pas d’un livre
Athènes . Rendez vous féministe et solidaire était donné le 8 mars
En Arès, le rat noir hellénophile attend le printemps.
Hommage au philosophe, René Schérer
Pour un mois de février à ne pas mettre un rat dehors...
Le rat noir a fait au gui l’an neuf : merveille : son œuf mensuel.
Grèce. Un Rom de 16 ans tué par un policier pour un vol à 20 €
Pour finir l’année avec le rat noir
Commémoration du 17 novembre 1973, hier à Athènes
Ballade en novembre pour le rat noir
Finies les vendanges en octobre, le rat noir fomente en tonneau
"C’est en septembre que je m’endors sous l’olivier." rêve le rat noir
Coming août, voici le rat noir.
Le rat noir lit à l’ombre en juillet
Gay Pride Athènes 2022
En mai, le rat noir lit ce qui lui plaît.
En avril, le rat noir ne se découvre pas d’un livre.
Encore un peu du rat noir pour mars
Le rat noir de mars
Vite, le rat noir avant que mars attaque...
Février de cette année-là, avec le rat noir.
Une fin de janvier pour le rat noir
deux mille 22 v’là le rat noir
Le Rat Noir de décembre...
Un rat noir de fin novembre...
Début novembre, le rat noir est là
Octobre, nouveau message du rat noir
revoilà le rat en octobre
Le message du rat noir, fin septembre
La rentrée du rat noir
La fin août du rat noir
Mi-août, voilà le rat noir !
Le rat noir, du temps de Jules au temps d’Auguste
Le rat, à l’ombre des livres
Interview de Barbara Pascarel
Le rat noir, fin juin, toujours le museau dans les livres
Un bon juin, de bons livres, voilà le rat
On est encore en mai, le rat lit encore ce qui lui plait
En mai le rat lit ce qui lui plait
Fin avril, le rat noir s’est découvert au fil de la lecture
Un rat noir, mi-avril
Une nouvelle Casse-rôle sur le feu !
Qu’est Exarcheia devenue ?
V’là printemps et le rat noir en direct d’Athènes
Le rat noir de la librairie. Mois de mars ou mois d’arès ? Ni dieu ni maître nom de Zeus !!!
Librairie athénienne. un message du rat noir
Le rat noir de la librairie athénienne. Février de cette année-là.
Le rat noir d’Athènes mi-janvier 2021
Le rat noir de la bibliothèque nous offre un peu de poésie pour fêter l’année nouvelle...
Volage, le rat noir de la bibliothèque change d’herbage
Octobre... Tiens, le rat noir de la bibliothèque est de retour...
Le rat noir de la bibliothèque pense à nous avant de grandes vacances...
Maurice Rajsfus, une discrétion de pâquerette dans une peau de militant acharné
Juin copieux pour le rat noir de la bibliothèque.
Juin et le rat noir de la bibliothèque
Mai : Le rat noir de la bibliothèque
Séropositif.ves ou non : Attention, une épidémie peut en cacher une autre !
Mai bientôt là, le rat de la bibliothèque lira ce qui lui plaira
Toujours confiné, le rat de la bibliothèque a dévoré
Début de printemps, le rat noir de la bibliothèque a grignoté...
Ancien article Des « PD-anars » contre la normalisation gay !
mars, le rat noir de la bibliothèque est de retour
Janvier, voilà le rat noir de la bibliothèque...
Vert/Brun : un "Drôle de couple" en Autriche !
Ancien article : Stéphane S., le poète-philosophe libertaire au « Sang Graal »
Algérie : l’abstention comme arme contre le pouvoir
Décembre 2019 : Le rat noir de la bibliothèque
1er décembre, journée mondiale contre le sida : les jeunes de moins en moins sensibilisés sur la contamination
A Paris, bientôt de la police, partout, partout !
Les Bonnes de Jean Genet vues par Robyn Orlin
N° 1 du rat noir de la bibliothèque
En octobre et novembre le ML avait reçu, le ML avait aimé
Razzia sur la culture en Turquie
Ces GJ isolés qui en veulent aux homos !
Service national universel pour les jeunes : attention, danger !
Vers l’acceptation de la diversité des familles dans la loi ?
Une petite info venue de Grèce
Le philosophe à l’épreuve des faits
La Madeleine Proust, Une vie (deuxième tome : Ma drôle de guerre, 1939-1940)
Loi sur la pénalisation des clients : billet d’humeur
Les anarchistes, toujours contre le mur !
Le Berry aux enchères
1 |
le 6 octobre 2025 15:35:28 par Patricia |
Sympa cette nouvelle liste de livres dont Mon chien Stupide , un livre très charmant d’après mon souvenir et le titre délicieux !
Patounette
2 |
le 6 octobre 2025 15:36:36 par Stef |
Que de livres dans la tête du rat noir, on se demande s’il y a encore de la place !!!
Merci pour ces découvertes
Stéphane
3 |
le 6 octobre 2025 18:08:25 par Le Pivert |
Étonnante chanson de Boris Vian sur la rue Lauriston. Très puissante. Merci à l’équipe du Rat noir
Pivert
4 |
le 7 octobre 2025 11:43:51 par Max |
Le livre de John Fante "Mon chien stupide" je l’ai croqué sur tes conseils. J’ai ri et l’ai fermé ému. Quant à Michèle Bernstein "Tous les chevaux du roi" cela fait un moment que j’ai envi de la rencontrer. Surtout que là en plus, lors de cet interview , elle pétille d’intelligence et d’humour : [LIEN]
Merci mon cher Patrick, de m’avoir proposé ces diverses rencontres.
5 |
le 9 octobre 2025 17:34:56 par Jehan v L. |
John Fante...les livres qui suivront l’histoire de son chien Stupide : je crois.. du grand du très grand ...
Baci
Jehan