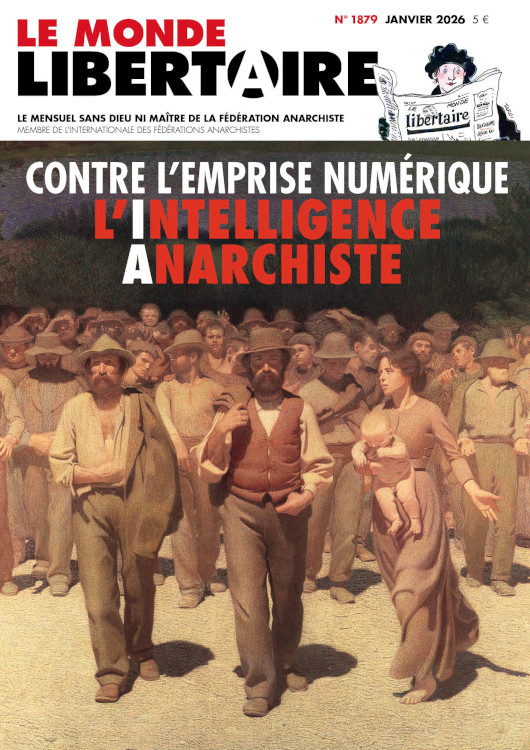Décroissance, quoi de neuf ?
mis en ligne le 28 novembre 2013
Reste que ce diagnostic ne constitue pas un projet de société. La diversité des approches concernant la décroissance masque souvent le vide politique ou le fourvoiement dans des pistes marécageuses. Sous prétexte de ne pas imposer de solutions toutes faites, et tournant souvent en dérision – par frivolité ou lâcheté – la notion ambiguë de « grand soir », elle évacue le vrai débat politique. Comment, d’un monde invivable, naîtra – sans conflit – une société sereine ? On ne le saura pas.
Le livre collectif récemment paru sous la direction d’Agnès Sinaï, maître de conférences à Sciences-po – Penser la décroissance – n’échappe pas à la règle. Et pourtant, un élément aurait pu permettre d’approfondir le débat politique. Alice Le Roy, journaliste, évoque une photo satellite (prise en 1998) des zones pastorales situées aux confins de la Chine, de la Russie et de la Mongolie, qui permet d’observer que les tribus nomades qui, côté mongol, géraient le territoire avec des systèmes de propriété collective, rencontraient moins de problèmes de surpâturage que les exploitations situées en Chine, où elles ont été tour à tour nationalisées puis privatisées, ou encore côté russe, où elles étaient toujours sous contrôle étatique. Quel meilleur hommage au projet anarchiste ?
L’humanité dans une impasse
Que nous apprend ce livre ? Si la formation technologique de l’Occident a demandé mille ans, selon Lewis Mumford, l’explosion énergétique, elle, date de deux cent cinquante ans. À partir de 1750, le recours massif au charbon en Angleterre ouvre l’ère de l’Anthropocène, c’est-à-dire la période où les sociétés industrielles concurrencent les forces telluriques, où une partie de l’humanité est devenue une « force géologique ». Il est encore difficile de mesurer les conséquences de cette artificialisation du monde, de ce changement d’échelle temporelle, de cette rupture dans l’histoire (le règne des énergies fossiles ne représentera qu’une infime parenthèse dans l’évolution géologique de la Terre depuis quatre milliards et demi d’années).
C’est une modification sans précédent de notre rapport au monde (et notamment la capacité accélérée d’exploitation et de destruction des différents milieux) ; c’est l’abandon des énergies renouvelables (bois, moulins à eau et à vent). C’est aussi la systématisation d’un rapport de violence envers la nature (exploitation des ressources), mais aussi à l’égard de l’homme (commerce des esclaves). Déforestation, pollutions, épuisement des ressources, appauvrissement des sols, perte de biodiversité, perturbations climatiques…, tous les clignotants de la biosphère sont au rouge. La période des énergies faciles et bon marché s’achève au sein des sociétés malades de leur propre croissance.
Un avenir imprévisible
Pour assurer sa survie, le système se lance dans une redoutable fuite en avant de technologies coûteuses et agressives, qui n’empêchera nullement le renchérissement du coût des énergies. Ces pistes risquent bien de n’être que des mirages. Ce que nous préparent les écolo-technocrates, c’est une rationalisation centralisée de la production industrielle et agricole mondiale, qui s’accompagne d’une société de contrôle et de surveillance des flux du bétail humain grâce aux progrès des nanotechnologies et à la miniaturisation de l’informatique. Des réponses techniques à des questions soulevées par la technique, en sachant que celle-ci « s’auto-accroît » (voir Ellul, Illich, Gorz) tout en échappant aux processus « démocratiques ». Ce projet, c’est la planification de la vie, c’est-à-dire son mépris et sa négation.
Ce désarroi de la « mégamachine » se manifeste notamment par la multiplication des grands projets qualifiés de coûteux, inutiles et destructeurs. Il semble en effet que l’objectif de ces temples de la démesure ne soit pas seulement la recherche effrénée du profit mais le maintien sous perfusion d’un système productiviste qui ne doit sa survie qu’à une croissance permanente. Alors que nous croulons déjà sous les équipements et les infrastructures surdimensionnés, ces projets, qui s’appuient essentiellement sur les fonds publics, alourdissant d’autant les dettes, visent essentiellement la relance d’une économie atone. Probablement un chant du cygne, mais qui a la redoutable fonction de privatiser, de militariser les territoires et de criminaliser les oppositions. C’est ainsi qu’en juillet dernier, le Premier ministre présentait un plan d’investissement – censé financer la transition écologique du pays ! — qui comporte huit projets autoroutiers, la ligne LGV Bordeaux-Toulouse et l’axe Lyon-Turin ! De quoi assurer largement le bonheur au quotidien ! Sur le plan écologique, rappelons que nous abordons non seulement le pic du pétrole (période de stagnation de la production avant le déclin inéluctable), mais aussi celui des autres ressources dont nous sommes devenus extrêmement dépendants. Même si ces ressources semblent encore considérables, leur qualité et leur accessibilité se dégradent. Les découvertes majeures ayant été faites, il existe très peu de gisements nouveaux. Les rendements étant de plus en plus faibles, les dépenses énergétiques et financières pour l’extraction augmentent. Pour la grande majorité des métaux, les réserves se situent entre trente et soixante ans (autant de métaux ont été extraits en une génération qu’en toute l’histoire de l’humanité). De la même manière, le potentiel des ressources océaniques ne sera accessible économiquement qu’à la marge. Quant aux énergies renouvelables elles-mêmes, elles exigent aussi des ressources de plus en plus rares. Permettant de réduire le taux d’extraction des métaux, le recyclage risque également de n’être qu’un miroir aux alouettes. Passer d’un taux de 40 % à 80 % de recyclage multiplie mathématiquement les ressources par trois. Mais les niveaux de recyclage sont étroitement limités, d’une part, par la complexité des produits, des composants et des matières (milliers d’alliages métalliques différents, matériaux composites), d’autre part, par les usages dispersifs (pigments dans les encres et les peintures, catalyseurs, fertilisants, pesticides…). Jusque-là, on ne peut qu’être d’accord avec le contenu du livre. C’est après que ça se corse.
Le déni du politique
Parce qu’il ne suffit pas de stigmatiser le jetable, l’obsolescence, de fustiger les dogmes et illusions de la croissance, de condamner le développement durable, de se lamenter sur les échecs répétés des sommets internationaux et de la gouvernance mondiale… pour proposer les mêmes tisanes. Repenser en profondeur la conception des objets, les rendre à nouveau réparables et réutilisables, faciliter leur recyclage en fin de vie, n’utiliser qu’avec parcimonie les ressources les plus rares, abandonner les programmes de lignes ferroviaires à grande vitesse, d’autoroutes. Certes, mais après. L’enfermement local, le repli sur soi ne guettent-ils pas le manque de perspective politique ? Et faudrait-il croire que la convivialité suffira lorsque les dominants s’apprêtent à faire usage de la force brutale aux premières menaces de renversement, comme ils l’ont toujours fait dans l’histoire ? Comment peut-on prétendre anticiper les chocs énergétique et climatique, créer de nombreux emplois avec un retour massif à l’artisanat, à la petite industrie et au commerce de proximité, favoriser la renaissance, la redynamisation des villages et des bourgs sans envisager la sortie du capitalisme et la destruction de l’État, sans remettre en cause la propriété privée des moyens de production ? Comment préconiser le partage des biens communs en se contentant de remettre à leur juste place l’État et le marché ? Comment instaurer un « nouveau pacte social » en se limitant aux réseaux d’échanges, aux villes en transition, aux écoquartiers ou aux circuits courts, malgré tout l’intérêt et la valeur pédagogique que peuvent porter ces modes d’organisation coopératifs ? L’hypocrisie, l’ignorance, la naïveté – et les vœux pieux qui les accompagnent – n’ont jamais conduit qu’à maintenir les rapports de force et de domination. Vient un moment où il faut prendre ses responsabilités.
Pour une décroissance libertaire
Et pourtant, sortir du capitalisme et de l’État ne suffira pas non plus. Le constat n’est plus à faire : il est désormais impossible de maintenir les niveaux actuels de dépense énergétique, de mobilité ou de consommation, impossible de penser le futur comme une continuation du passé. La croissance n’est pas la solution mais le problème. La démesure et la fragilité de la civilisation thermo-industrielle nous acculent aujourd’hui à anticiper un effondrement possible. S’il est évident que l’homme a pu, longtemps, transformer de manière favorable les différents milieux, l’économie prédatrice sans mode de restitution, le projet démiurgique de contrôle de la nature conduisent désormais à s’interroger sur les conséquences négatives de l’activité humaine. Il faut souligner ici la responsabilité de certains intellectuels dans le discours anti-écologiste, le déni des limites. C’est l’hostilité quasi viscérale à toute limite posée à la transformation de la Terre par l’humanité qui a étouffé la critique d’un modèle occidental soucieux d’espaces domestiqués, pour mieux exempter l’homme de toute responsabilité dans la dégradation des écosystèmes. Comme si la nécessité de se conformer aux lois de la physique et de la biologie enlevait quoi que ce soit à la grandeur – possible – de l’homme.
Entre ceux qui prétendent que l’écologie constitue un projet politique en soi et ceux qui s’obstinent à nier l’importance vitale des bases matérielles de l’activité humaine, il y a au moins un point commun : l’incapacité à penser globalement. C’est parce qu’un projet anarchiste qui n’intègre pas la dimension écologique est aussi stérile qu’un concept de décroissance qui refuse de définir clairement un cadre politique, qu’il faut s’attacher à lier indissolublement la question sociale et la problématique écologique. « Les développements de l’humanité se lient de la manière la plus intime avec la nature environnante. » (Elisée Reclus, Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, 1866.)