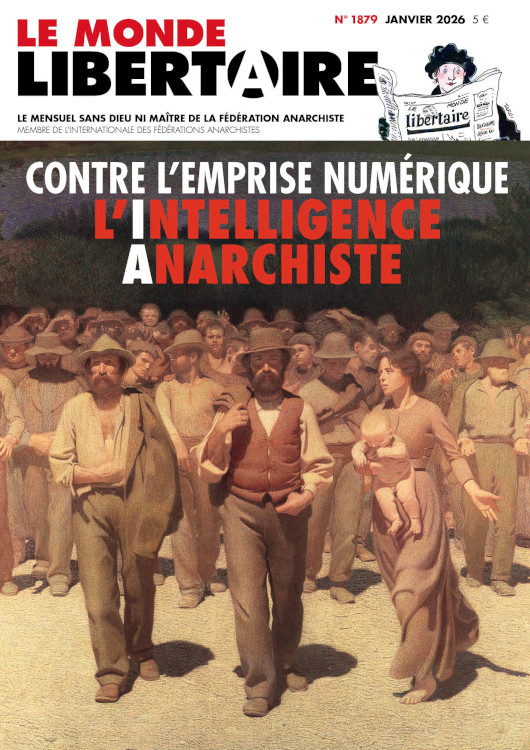Rupture anarchiste et trahison proféministe
mis en ligne le 3 octobre 2013
En tant que féministe, je n’attends pas le Sauveur. Je sais que, quel que soit l’homme qui est en face de moi, il est celui qui bénéficiera de l’oppression des femmes, de l’oppression que, jour après jour, je subis. Quoiqu’il en dise. Qu’il l’admette ou non. Je l’ai appris à mes dépens, après des années de discussions affectueuses mais infructueuses auprès de mes camarades et compagnons.Au départ, je voulais tenter de changer les choses en faisant appel, avec le plus de pédagogie possible, à leur cohérence, leur amour et leur amitié. Il faut bien l’avouer, cette méthode a toujours lamentablement échoué. À présent, je trouve que le petit cri que j’ai longtemps poussé, « s’il te plaît, renonce à tes privilèges et cesse de m’écrabouiller, si tu veux bien, tu seras gentil, s’il te plaît, s’il te plaît ! », était un petit cri assez pitoyable. Mais c’était le seul petit cri que je savais pousser. Quand on vous coince les doigts dans une porte, il est assez surprenant de constater la première fois que tout ce qu’on sait faire c’est de demander gentiment si on n’a pas sali la peinture avec son sang, avant de s’excuser puis de nettoyer. Pire, plus on se fait coincer les doigts dans cette porte, moins on pense qu’il nous est possible de faire autre chose que de pousser ce petit piaillement.
Car nous sommes dressées à nous excuser lorsque l’on nous coince les doigts dans la porte. Nous sommes dressées à croire que c’est de notre faute, qu’on n’aurait pas dû laisser traîner ses doigts et qu’on l’a bien cherché. Nous avons du mal à prendre conscience de notre droit à vivre dotées de nos dix doigts, sans que l’on nous blesse ou nous coince. Nous avons du mal à prendre conscience de notre propre dignité, comme l’écrit Christine Delphy, et à exiger qu’en face, on en tienne compte.
Pas par gentillesse ou grandeur d’âme, comme si l’on nous accordait un luxe, une cerise sur le gâteau, non, mais parce que nous avons le droit et nous exigeons de vivre autrement que comme des bêtes, à hanter la cuisine comme les rats hantent les égouts, autrement que comme des balais à chiotte, des trous ou des ventres sur pattes.
J’avais donc tendance à m’excuser quand on me coinçait les doigts dans la porte, mais un jour, j’ai pris conscience que mes mains, si longtemps entravées, pouvaient former un poing. Pour cogner. Et cela notamment grâce aux mots de Christiane Rochefort « Il y a un moment où il faut sortir les couteaux. C’est juste un fait. Purement technique. Il est hors de question que l’oppresseur aille comprendre de lui-même qu’il opprime, puisque ça ne le fait pas souffrir : mettez-vous à sa place. Ce n’est pas son chemin. Le lui expliquer est sans utilité. L’oppresseur n’entend pas ce que dit son opprimé comme langage mais comme un bruit. C’est la définition de l’oppression […] L’oppresseur qui fait le louable effort d’écouter (libéral intellectuel) n’entend pas mieux. Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C’est ainsi que de nombreux mots ont pour l’oppresseur une connotation-jouissance, et pour l’opprimé une connotation-souffrance.
Ou : divertissement-corvée. Ou loisir-travail. Etc. Aller donc communiquer sur ces bases. […] C’est ainsi que la générale réaction de l’oppresseur qui a écouté son opprimé est, en gros : mais de quoi diable se plaint-il ? Tout ça c’est épatant.
Au niveau de l’explication, c’est tout à fait sans espoir. Quand l’opprimé se rend compte de ça, il sort les couteaux. Là on comprend qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Pas avant.
Le couteau est la seule façon de se définir comme opprimé. La seule communication audible. »*
J’ai alors réalisé que mes plaintes, mes piteuses tentatives d’explications pédagogiques et patientes, se résumaient en réalité à ceci : pisser dans un violon. Si comprendre cela m’a fait du bien, il m’a également été douloureux de réaliser que l’intimité que je partageais avec un homme et les sentiments que j’avais pour lui s’inscrivaient dans le cadre de rapports oppressifs, hiérarchiques et donc violents.
« Tout cela est donc si minable, alors ? », me suis-je demandé. Cela a été long pour que j’envisage notre société patriarcale autrement que s’exprimant à l’extérieur de moi ou du couple que je formais. Car comment vivre en sachant qu’elle est en nous, qu’elle infiltre notre manière d’être, de penser, d’agir et de ressentir ? Comment trouver la force de se regarder, de nous regarder ? J’ai commencé à accepter de voir, grâce à de grands textes féministes qui ont dessillé mes yeux. J’étais d’accord pour enfin regarder et essayer de comprendre… mais que faire ?
Que faire lorsqu’on découvre que nos compagnons de lutte, ceux-là même qui se disent engagés contre toutes les formes d’oppressions, préfèrent bien souvent ne pas voir celles dont, en tant que mâles, ils tirent d’évidents bénéfices ? Que faire lorsque l’on découvre que si nos camarades veulent bien gueuler contre l’ordre des choses, ils ne veulent surtout pas remettre en cause celui qui vous écrase et leur rend, à eux, tant de services : continuer à pouvoir baiser quand ils veulent et comme ils veulent, rentrer dans un petit chez-soi où l’intendance tourne sans accroc (et surtout sans eux), que la bouffe arrive, que le slip soit propre ; pouvoir causer tranquillement en tribune en décidant de l’ordre du jour, des combats légitimes et des luttes prioritaires…
Comment accepter qu’il soit si difficile d’être féministe au sein d’espaces où, pourtant, on devrait trouver le repos et l’énergie pour lutter ? Mauvaise foi, déni, ironie, humiliations, violences… tout est fait pour nous conduire, nous militantes, à la résignation : se contenter de, marcher sur des œufs puis finir par se taire et tenter de digérer un vague sentiment de défaite, une déception dont on espère que l’amertume sera passagère. Bref, renoncer à se battre pour soi, à penser sa place au sein des luttes comme en cuisine… et se préparer à avaler les couleuvres qui, déjà – encore et toujours – se profilent.
Face à ces douloureux constats, beaucoup de féministes sont tentées de jeter le bébé avec l’eau du bain en se disant : « Puisque je n’ai pas la force de lutter partout, tout le temps, jusqu’au sein des collectifs militants où je suis engagée, jusqu’au cœur de mes amitiés et de mes amours… autant tout arrêter. » Et il faut avouer que cela peut être reposant, au début : plus d’arguties, de débats interminables, ni de cruelles déceptions. Parce que c’est épuisant de ne jamais baisser les armes, de toujours être sur le qui-vive et de devoir même se défendre de ceux qu’on aime.
On voudrait demander l’asile, un lieu où l’on pourrait, l’espace d’un instant, souffler un peu et se retrouver. Mais on comprend rapidement que c’est un tout autre asile que l’on promet la plupart du temps à la féministe de service : celui-ci est plutôt réservé à la folle qui jamais n’est contente, l’hystérique qui toujours dérange, empêche les réunions de se dérouler comme prévu ; celle qui fout la merde au sein du groupe, qui demande à ne pas toujours être cantonnée au ménage du local, qui ne veut pas accepter les remarques sexistes qu’on lui impose, qui parle de violences là où l’on préfère parler de « drague un peu lourde », bref, celle qui braque la lampe sur ce que l’on voudrait tant maintenir dans l’ombre.
Si certaines jettent l’éponge, d’autres maintiennent le cap. Mais à quel prix ? Usure, solitude, découragement, stigmatisation, mise à l’écart… Pour continuer dans ces conditions, il faut une énergie sans faille, beaucoup d’humour et de sacrées armes. Les écrits de Léo Thiers-Vidal font indéniablement partie de ces armes-là.
Plus encore, en le lisant, on a le sentiment d’avoir trouvé un ami, un frère et un véritable compagnon de lutte. Son humilité, son exigence, son empathie et sa colère forcent le respect. Car il faut bien admettre que ces qualités sont assez rares lorsque l’on discute avec des militants et/ou des chercheurs hommes réfléchissant aux rapports sociaux de sexe. L’humilité, par exemple, fait souvent défaut. Combien ai-je rencontré ou lu de leurs écrits qui me donnant le sentiment qu’ils posent leurs idées comme s’ils posaient leurs deux énormes testicules sur le papier ? Ils savent, ils ont compris et se pensent au-dessus de la mêlée. Parce qu’ils ont quelques lectures à leur actif, dont ils ne retiennent généralement que ce qui les arrange. Ils débarrassent parfois le lave-vaisselle et savent changer la couche de leur bébé ; ils se mettent à croire que leur grande tête est une ampoule géante qui éclaire le monde.
Généralement, quelques mois auparavant, ils écoutaient tes propos, lisaient les livres que tu leur conseillais et essayaient de penser les concepts que tu passais des heures à leur expliquer… Mais très rapidement, ils se sont pris pour la tête pensante du mouvement féministe. Ils se disent plus féministes même que les féministes et savent généralement mieux que toi ce que c’est d’être une femme, ce qu’est le féminisme, quelles sont ses « priorités » et « comment l’articuler aux autres luttes ». Ils reprennent alors leur place sur le devant de la scène et retournent le féminisme comme un gant, en deux temps, trois mouvements. Ils deviennent Le Sauveur que tu attendais, selon eux. Et tu as intérêt à leur en être redevable. On dit merci au Monsieur. Il faut avouer que, la première fois, on trouve le tour de passe-passe assez bluffant.
Renforcer le système patriarcal en ayant l’air, de prime abord, faussement subversif est donc très aisé. Mais le renforcer en croyant, de bonne foi, qu’on tente de le subvertir, est hélas tout aussi facile. Or, l’exigence de Léo Thiers-Vidal lui a permis de dépasser cet écueil. Cette exigence est triple : lire réellement les travaux des chercheuses féministes, c’est-à-dire sans évacuer ce qui pourrait être susceptible de le déranger ; ne jamais oublier qu’il pense les rapports sociaux de sexe à partir d’une position oppressive et enfin, s’engager concrètement aux côtés de militantes féministes, des femmes, et plus largement, des opprimées et opprimés.
Cette humilité et cette exigence ont permis aux textes de Léo Thiers-Vidal de sonner juste… et fort, grâce à la colère et l’empathie qui les animent. Ces textes sont comme autant de camarades auxquels on a envie de donner la main, avec la sensation qu’on ne nous écrabouillera pas les doigts, cette fois-ci. Il ne s’agit pas de les regarder avec les yeux mouillés de la groupie reconnaissante. Bien au contraire. Ces textes sont des scalpels pour disséquer le dominant, l’oppresseur – mon dominant, mon oppresseur – ; des scalpels taillés pour couper dans le vif, des armes qui ne s’useront que si on s’en sert pas.
Mademoiselle
* Définition de l’opprimé dans la présentation de la traduction française de Scum Manifesto de Valérie Solanas, Paris, La Nouvelle Société, 1971.
COMMENTAIRES ARCHIVÉS
Fredo
le 18 octobre 2013
Solanas est de retour. Aux abris les mecs ! Planquez vos couilles !