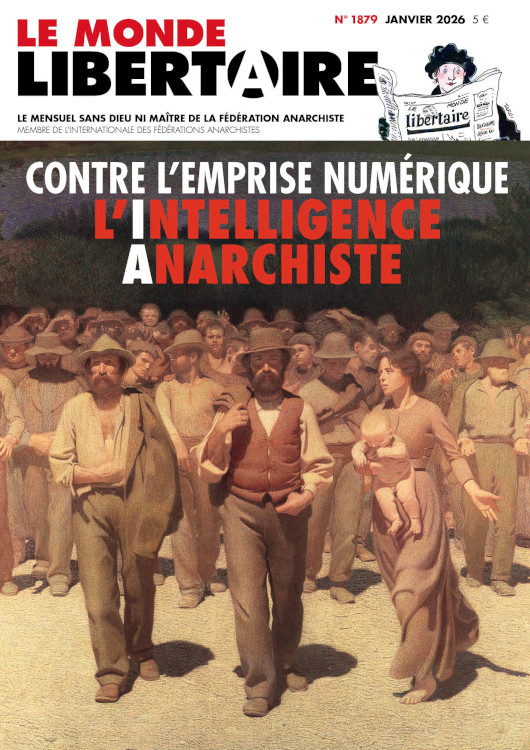Je célèbre ce jour Armand Robin, l’homme à qui j’EN veux le plus ! Partie 1
mis en ligne le 5 mai 2011
Comment EN (NE) vouloir à…
J’EN veux à Armand Robin. S’il y a un écrivain à qui j’EN veux le plus, c’est bien lui. Pour toutes sortes de raisons, dont je ne livrerai que les principales, relevant quasiment de l’évidence – les autres, les secrètes, les ténébreuses, demeurant, elles (c’est imprécisément l’« EN »), enfouies dans on ne sait quelles cryptes de l’inconscient, couvées ou cuvées dans l’ombilic des mots. Je sors ici les griffes de mes griefs, tout en abandonnant l’« ahan » trop accablant de ce « EN » lourdingue obscur fonçant sur nous en lettres capitales (l’EN étant renversé en NE, rassemblant ainsi en lui toute l’énergie du « Ça » de la psychanalyse). Je lui en (des minuscules, désormais) veux de me contraindre à parler de lui – lui qui est par-dessus tout homme de parole et d’écoute, et n’a nul besoin d’un quelconque « communiquant », terme qu’il exécrerait ; je lui en veux de devoir prendre sa défense – lui dont l’œuvre et les activités ont une telle poigne, levée, et une telle rigueur que nul défenseur ne saurait être requis ; je lui en veux de l’ainsi mettre en avant, sur le « devant » (en latin ob) de la « scène » médiatique, le tirant du coup vers l’« obscène » – lui qui en quelques mots, en quelques formules lapidaires, pulvérise les obscéniques poses et lèches, mensonges et « niaiseries » dont s’empiffrent et se farcissent maîtres des lieux et leurs valetailles. Suffit d’ouvrir la télé : noms et faces de politiciens, journalistes, animateurs, truands et frimeurs en tous genres vous sautent au visage, faces de boucs lubriques, de chiens jappant, de louves voraces, de poules coquetantes, de renards chapardeurs, faune téléastique devenue domestiquement omniprésente, dont les dentures éblouissantes éblouies et les yeux allumeurs allumés s’affichent et se succèdent en cascades comme écus d’or croulant d’une machine à sous (c’EN est une).
Je lui en veux de m’obliger à utiliser, d’entrée de jeu, et pour pouvoir rentrer dans son propre jeu à lui en dressant une espèce de « bulletin d’écoute », des expressions auxquelles habituellement je répugne, dont la tournure superlative « le plus », qui aujourd’hui arpente tous les trottoirs, tsunamise rues et boulevards, engorge presses et chaînes des bêlements et flagorneries journalistiques et politiques agglutinés à quelques glaireux gargarismes de glosants « philosophes ». Suffit d’ouvrir une radio : « le plus grand », adorné d’un « absolument », prolifère en tous sens, polysémillant, à s’en dévisser les vertèbres et déglutir sa langue de bois. Jaillit, couramment associé à ce « le plus » absolu, l’absolu mot « génie », distribué à tous vents : mot qu’à seulement le prononcer (« génial » !) celui qui le prononce s’y croit, et s’en accroît – voyez-vous ça, c’est fort de café, ça – et s’en fait même miroir et miroitement. Les mimiques de l’auto-éblouissement se pressent au portillon du petit écran – pour une lancinante monstration (ils se sacrent « monstres », en plus !), et fabuleux rapport qualité-prix (qualité : néant ; prix : exorbitant). J’éviterai donc de déclarer que Robin est le plus grand traducteur que je connaisse (que l’on me cite un « le plus » que lui – et j’ouvre derechef son robinet à langues, les trente ou quarante langues qu’il a pris à la gorge, littérairement parlant, lui, l’homme à la voix de gorge profonde), et j’éviterai conséquemment d’affirmer qu’il a, ou, mieux, qu’il est le « génie » de la traduction – tel que, parcourant allègrement tant de territoires de vivace création langagière, il est parvenu, lui haut couturier virtuose cousant ses textes au point du « non », au fil du « sans », à nous donner à désirer et à sentir ce que pourrait être, en son poignant murmure, une « outre-langue » – originelle, première, matriciante, d’humanité.
« Oh les beaux jours » du NON
Quel nom donné, outre l’outrance, à cette « outre-langue ? Laissant toute sa noblesse et son charme propre, élégamment valéryen, au genre « traduction de… » auquel se consacre tel ou tel traducteur connu ou inconnu (tradutore qui, s’il travaille juste, serait-ce pour d’exsangues rémunérations, n’est nullement, comme aiment dire les cuistres, un traditore, un « traître » trahissant le texte originel, mais bien au contraire un « auteur » qui, par l’apport de sa propre richesse langagière, accroît – du latin augeo, « augmenter » – la qualité et les vibrations intrinsèques du texte premier), on pourrait dire de Robin qu’il est le plus grand « traduisant », le praticien fulgurant d’une « traduisance », ou mieux d’une « transduction » – si l’on veut bien entendre en ce « trans » le souffle d’une originaire « transe » poétique qui nous conduise (duction, de ducere) vers l’être primordial, « métaphysique », de la langue – son « âtre calme ». Le mieux serait encore de reprendre son propre terme, « non-traduction » : en cette expression s’avère le « génie » même de Robin, rare génie, qui est génie du rare, génie du « non », génie du « sans » (c’est peut-être bien lui, en vrai, « l’homme sans qualité », l’outre-Musil par excellence), génie du retrait (tel le tsimtsoum kabbalistique divin, qui vaut suprême prescription humaine), génie de l’évidement, génie du « rien » (son autre mot favori) – le nihilisme pur de l’anarchie, qui ingère le « rien » pour le recracher semence.
Il s’est voulu, délibérément, on dirait presque mystiquement (la « raison ironique » toujours précieusement préservée) : non-génie – « non-génie » pour « non-traduction », où le « non », facteur de vérité, ainsi envoyé passionnément en uppercut oxymorique, désignerait une forme souveraine, ouverte à tous sens, de traduction créatrice – par delà mots, sens, rythmes, musiques et non-dits, qu’elle se garde bien d’embarquer dans quelque nymphatique non-nef que piloterait une non-muse. (Plus d’un, cependant, tentèrent d’embarquer Robin dans une nef des fous : Robin rappelle qu’Aragon le désigna – à quelle police littéraire ? – sous le nom d’« Abraham Robinovitch fuyant l’URSS avec Victor Serge » – la police, elle, le débarqua, tenu pour « dingue », cellulairement, à l’Hôtel-Dieu.) Ce à quoi nous engage la « transduction » ou « non-traduction » pratiquée par Robin, telle que rendue lisible, visible (là réside véritablement la vraie « visibilité ») dans les textes de Poésie sans passeport, Écrits oubliés et autres, c’est à nous mettre hardiment, joailleusement (oh, comme nous les entendons se croiser, caramboler en jeux de perles de vers, tous ces mots par lui ouvragés enfilés diamants !) à l’école du NON – la seule école, peut-être (qu’on m’en cite une autre, et je m’« écraserai » platement d’un « oui » – néanmoins grevé de l’indispensable « mais ! »), capable de dégonfler les baudruches politiciennes et médiaticiennes qui nous « gonflent », nous dévorent l’espace, nous exténuent le souffle, moulinent notre temps vivant en fumeuse et marécageuse écume où s’enlisent, hallucinés, théâtralisés en habillage à la Beckett, nos rêveries d’« oh, les beaux jours ! »
Chiffres fous pour outre-vie
« Au final », comme on dit (comme si l’on pouvait parler de final), « le plus grand » et son compère le « génie » nous ont bien eus, au contournement de l’œuvre. Alors, eux là, il faut bien se résoudre à fournir quelques mesures. Selon sources et compétences, qu’auréole la rumeur, Robin aurait travaillé sur au moins vingt-cinq à trente langues, plus même, aux dires des plus enthousiastes. Dans sa présentation du recueil de traduction Poésie sans passeport, aux éditions Ubacs (1990), Françoise Morvan, qui a beaucoup œuvré sur Robin, précise, dans une note, que « Dominique Radufe a recensé quarante et une langues mentionnées dans le Bulletin d’écoute bi-hebdomadaire qu’Armand Robin rédigeait pour une trentaine puis une quarantaine d’abonnés […]. On répertorie des traductions de vingt-deux langues (allemand, anglais, arabe, breton, bulgare, chinois, espagnol, finnois, flamand, gallois, hollandais, hongrois, italien, kalmouk, macédonien, ouighour, polonais, russe, slovène, suédois, tchèque, tchérémisse) et des traductions possibles de l’hébreu, du gaëlique, du japonais, du grec et du latin (entre autres). Cela ne donne aucune indication sur la connaissance que Robin pouvait en avoir ». Une liste, plus qu’exhaustive, propose en note sur le web cet impressionnant dénombrement : « Dans le Tableau des langues écoutées [pendant les années 1955-1961], page 127 de La fausse parole, édition 2002 du Temps qu’il fait, on trouve par ordre : allemand, anglais, arabe, bulgare, chinois, espagnol, français, hindi ourdou, hongrois, italien, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, ukrainien et aussi albanais, araméen, arménien, bahasa, bielorusse, catalan, espéranto, estonien, finnois, grec moderne, hébreu, irlandais, japonais, latin, lituanien, macédonien, malais, mongol, norvégien, slavon (vieux), slovaque, slovène, yiddish. »
Vaste, en outre, est l’éventail des auteurs qu’il a doublés en langue, au double sens du terme : doublé dans l’autre langue, la française, et doublé dans son débordement, la poésie. Son « tableau » de chasse, pour le dire vulgairement, mobilise « les plus » grands maîtres, les « génies » enlistés et parfois même « empléïadés » dans le « patrimoine » universel – comme ne dirait pas Robin, qui serait pourtant « le plus » qualifié pour en parler. Il traduit du persan les Rubayyat d’Omar Khayyam ; de l’arabe le poète Imroul’qaïs (VIIe siècle) ; il traduit Goethe et Shakespeare, les poètes hongrois Ady et Attila Jozsef, le Polonais Mickiewicz, l’Espagnol Lope de Vega et le Sud-Américain Ricardo Paseyro, l’Italien Ungaretti, l’Américain Poë, les Russes Pasternak, Maïakovski, Essénine, Blok – il court même après le Chinois Tou Fou. Il s’attache, panachant sa non-traduction de coquetterie, à des langues aussi rares que le tchérémisse des prairies, lequel tchérémisse n’est ni un cavalier ni un yoghourt, mais, comme le précise le dictionnaire, « une langue finno-ougrienne de la Haute-Volga » – and so on.
En cette populeuse et pulpeuse Babel, qui donne le tournis, Robin circonscrit un centre de gravité, un axe impérieux autour duquel tourne l’entière humanité. Il le désigne clairement dans un poème de Ma vie sans moi, Le Monde d’une voix (Poésie/Gallimard, p. 128), où la quantité déconcertante vire en fringante qualité, chorégraphiée en ces termes :
Signes des hommes
Signes des hommes, voici pour vous mes nuitsLangue, sois-moi toutes les langues !
Cinquante langues, monde d’une voix !
Le cœur de l’homme, je veux l’apprendre en russe, arabe, chinois,
Pour le voyage que je fais de vous à moi
Je veux le visa
De trente langues, trente sciences.
Je ne suis pas content, je ne sais pas encore les cris des hommes en japonais !
Je donne pour un mot chinois les prés de mon enfance,
Le lavoir où je me sentais si grand.
Signes
De minuit jusqu’à l’aube, épanouie,
Parmi les fleurs tapies, puis épanouies,
Mi-vie, puis survie, vie, outre-vie !
Anti-Tour de Babel
Faisant tourner, en sa geste transductrice, sa mappemonde aux « cinquante langues », Robin s’emploie – son « métier » de poète et de journaliste – à tracer ou retrouver la trace, le tracé qui va « de vous à moi », la relation originaire sur laquelle est fondée cette forme primordiale d’humanité qu’est l’un-l’autre (l’« être-là-avec » de tout humain – il est difficile à la fois d’en sortir et d’en dire plus), l’axe central qui traverserait « toutes les langues » pour en faire sourdre leur sourde unité : « monde d’une voix », qui est voix du monde, monde qui est « monde d’une vie », vie qui est « vie sans moi » (ce « moi » si peu là au monde tout en y étant tout), un « sans moi » qui est « mi-vie » mais aussi, par ce vidage même, qui déleste et leste, plus que « vie », « outre-vie » – laquelle ne saurait être rien d’autre, en cette liaison « de vous à moi » (nous EN sommes tous là, n’est-il pas vrai, ludions surfant trampolinant en ce EN, sur haute et concrète « métaphysique »), que l’humanité en son essence, qui est « signes des hommes », « cœur de l’homme », « cris des hommes ».
Robin dessine une perspective singulière, qui pourrait être qualifiée à première vue d’« utopique » : à la fois antébabélienne, écho du temps édénique où l’humanité parlait d’une seule voix (tu parles !), au point d’exciter la jalousie des dieux (mythe de la Tour de Babel, figure de Prométhée en son piton), et antibabélienne, car récusant et dénonçant la malédiction divine qui fait de la pluralité des langues la source des écarts, heurts, conflits, maux et malentendus entre les hommes qui, n’arrivant plus à se parler, à s’entendre, s’entrecognent et s’entretuent. Contre la vision biblique de la Genèse, qui raconte que Babel fut un embrouillamini (Babel, de l’hébreu bâlal, « brouilla, babélisa » ; Babel n’est plus, étymologiquement, « Porte de Dieu », mais « ville d’embrouillement », cf. La Bible, Osty, Genèse, 11, 1-9), un Robin « anti-Tour de Babel », comme il se proclame, fait de la mosaïque des langues une fresque multipliant en tous sens les coruscants et résonants éclats de la parole humaine. Écoute donc bien ceci, ô petit homme (Reich : « Écoute, petit homme »), ô man, ô Adam kadmon, entends ce primordial bereshith : avant de parler ta langue, langue de ton pays (« bien-aimé », comme tu t’en targues), de ta « race » (tu te la tagues en tête, bêta), « tu parles homme, tu es homme de parole – homo loquens ! Il appartient à la poésie, telle est sa vocation, et telle son essence, de nous restituer, à travers le génie unique de chaque langue, cet élan créateur moteur de toute humaine parole. Pour le dire plus crûment (le cru du « langage cuit » – salut à toi, ô Desnos), il s’agit de faire rendre gorge à la langue, d’aller fouiller la langue jusqu’au tréfonds de la gorge pour atteindre une sorte de point de gorge imaginaire : premier, ombilical, matriciel, où se concocterait brut l’enrouement natif de la parole.
(S’il est vrai qu’une analogie ne fait pas preuve, elle n’en invite pas moins à tenter l’épreuve d’une homologie, telle celle qu’ici nous proposons : la psychanalyse, si profondément attachée à la parole, au « parlêtre » comme ils disent, ne serait-elle pas née de ce que, dans son premier grand rêve [« rêve du 23 au 23 juillet 1895 », « le premier rêve… soumis à une analyse détaillée », dit « rêve d’Irma »], Freud se voit farfouillant dans la gorge béante de sa patiente Irma, pour y voir, pour y lire, pour en détacher et élire « une grande tache blanche » qui sera l’écran blanc où viendra s’inscrire et discourir son invention, gorge figurant les « propylées » – image associée au « propyle » du rêve –, la grande porte par laquelle la psychanalyse fera son entrée ?)
1. Robin a été secrétaire de la Fédération anarchiste de la région sud de Paris et de la Seine.