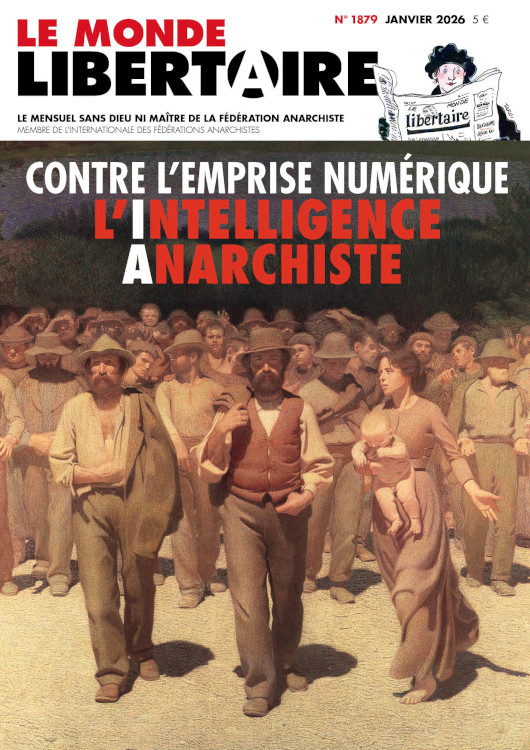67e Mostra d’Arte Cinematografica
mis en ligne le 23 septembre 2010
Trois aura été un des nombres magiques de cette 67e Mostra, car trois films ont illuminé la compétition : Norwegian wood de Tran Angh Hung d’après Murakami, des jeunes gens à l’épreuve des premiers émois confrontés à la mort d’un des leurs, œuvre de toute beauté au scénario soutenu par le grand écrivain ; Attenberg de Athina Rachel Tsangari, film grec d’une grande force, drôle et tendre, une fille avide de savoir ce qu’est un baiser ou approcher un corps du sexe opposé et de vivre l’approche de la fin du père adoré ; Le Fossé de Wang Bing, première fiction du documentariste chinois, un travail inspiré par le livre de Yang Xianhui 1 et des entretiens faits depuis deux ans avec les survivants du camp de Jiabiangou, prévu pour 400 personnes, où 3 000 furent envoyés, où 2 500 sont morts. C’était un camp de rééducation destiné à accueillir les dissidents (déviants droitiers). Film surprise 2 de la Mostra, Le Fossé de Wang Bing, œuvre ardemment à rétablir la vérité sur ce lieu de mort. Wang Bing a tourné secrètement dans une région oubliée du monde aux confins du désert de Gobi et de la Mongolie. Scène insoutenable où la femme d’un détenu cherche sa dépouille, déterre les morts recouverts de sable et pleure son désespoir contre ce camp, ses fonctionnaires, le vent et ce paysage grandiose indifférents. Comparé à ce film, plein d’autres apparaissaient « vides » de sens, mais peut être pas complètement « creux » comme, par exemple, Noir Océan de Marion Hänsel sur les essais nucléaires regardés par des jeunes marins sur un bateau de guerre. Le danger et les suites d’une irradiation certaine sont suggérés, jamais évoqués. Choix esthétique rigoureux ou complaisant de la réalisatrice qui parle de « ces jeunes qu’on aime et qu’on n’oubliera pas » ?Le Skolimowski, Essentiel Killing en l’occurrence, dépeint au détail près l’errance et la souffrance d’un homme, à qui Vincent Gallo donne sa chair et son regard de prince froid. Il sera revenu de la mort de multiples fois : après Abou Ghraïb et comme seul rêve, un fantôme de femme en burka bleue. L’errance et la fuite alors que les poursuivants sont supérieurs en nombre. On n’oubliera pas si vite comment cet homme affamé gratte l’écorce d’un arbre ou se jette sur une maman qui allaite son bébé pour boire lui aussi à son sein. L’exploit de Vincent Gallo, l’unique interprète de ce film quasi muet, efface les prétentions d’un vieux maître qui réussit plastiquement la dernière moitié du film. Pour le contenu idéologique, c’est assez vide et la coquetterie avec les images d’Abou Ghraïb est à la limite du mauvais goût. Alors que Kelly Reichardt (Wendy et Lucie) décrivant, dans Meek’s Cutoff, l’avancée de trois roulottes de colons à la conquête de l’Ouest — trois familles dont une femme enceinte à la merci d’un Indien qui les guide vers une source d’eau hypothétique — réussit mieux à laisser planer le danger, la peur de l’inconnu et rend tangible l’angoisse de se fier peut-être à un traître. La peur de l’autre est incarnée, alors que Skolimovski laisse à Vincent Gallo le soin d’incarner ce qu’il n’a pas toujours su dire. Alors que Post Mortem, film chilien sur la dictature et la vie d’un petit fonctionnaire qui dévoile sa part d’abjection, gagne son pari de raconter juste une histoire ordinaire, mais il la raconte avec les moyens du cinéma. Dès l’ouverture, notre regard passe sous les chenilles d’un char, placé devant la future scène majeure du film : deux maisons qui se font face. Une maison habitée par un homme qui désire la femme qui habite la maison en face. Ce dispositif fournit le cadre d’une tragédie privée qui rejoint la tragédie politique d’un peuple au moment du putsch de Pinochet.
Dans les sections parallèles, à Orrizonti en particulier, il y avait moisson de films plus originaux et riches en signification : Catherine Breillat d’abord avec son conte La belle endormie où elle mélange plusieurs contes de fée à la gloire au téméraire qui sommeille dans chacune des jeunes filles qu’elle montre dans ses films (signalons la rétrospective de ses films à la Cinémathèque française). Ou le film qu’Arnaud des Pallières consacre au destin d’une jeune fille de 15 ans, trouvée morte avec les ossements minuscules d’un fœtus à ses côtés : Diane Wellington, séquence, impressionnante de beauté, d’un long-métrage à venir : Poussières d’Amérique, basé sur un travail remarquable de recherche à partir d’archives inédites et d’un récit de Paul Auster.
Saluons aussi le nouvel opus de notre éternel jeune homme du cinéma en noir et blanc qu’il maîtrise comme peu d’autres : F.J. Ossang était de retour avec Dharma Guns. Sa star, Elvire, toujours aussi énigmatique et belle, et ses fidèles lieutenants de la cause de son cinéma, Guy McKnife, Lionel Tua et Diogo Doria, apportent ce qu’il faut pour prolonger la légende des films d’Ossang, décidément inclassables. Ses plans et son découpage sont du grand art et une preuve de la légitimité du cinéma en noir et blanc. Le cinéma quasi muet et une certaine lumière « allemande » ont encore de beaux jours devant lui. Aux antipodes de cette œuvre toujours d’avant-garde, avec des musiques géniales, il y avait un brûlot antifranquiste de Lluis Galter, un film sobre, austère même, aux images saisissantes pour conter l’errance de l’anarchiste Ramon Vila au surnom de Caracremada (titre du film), chef de file des anarchistes catalans désobéissants aux directives des chefs, installés à Toulouse. Ramon Vila continuait seul la lutte contre Franco en tuant autant de guardia civils qu’il pouvait. Mort dans une embuscade, son corps fut ramené au village sur une charrette dont pendouillait son légendaire pistolet au bout d’une corde. Ses chaussures furent gardées et exposées dans un musée. C’est là que l’auteur du film est allé pour choisir les chaussures de son personnage du film incarné avec sobriété par Lluis Soler et d’autres visages inconnus, mais inoubliables.
Héros d’une cause, anti-héros défendant juste la vie et rien d’autre, les modèles que proposait cette édition de la Mostra ne manquaient pas de nous interroger sur la pérennité des images d’Épinal ou des clichés à la mode. La libération absolue de l’individu et de la sexualité pratiquée selon notre désir, le « jouissons sans entraves » était tenté par Happy few de Antony Cordier et Drei (Trois) de Tom Tykwer. Finalement, le réalisateur allemand réussit mieux de faire imaginer le désir vainqueur de nos peurs ancestrales d’une sexualité libre que son homologue français qui expose les plaisirs des sens et se résigne à montrer une fin pessimiste, assez réaliste de ce genre d’aventure.
Les films en dehors de ces genres, somme toute assez convenus, étaient rares : Jean Gentil de Israel Cardenas et Amélia Guzman, balade triste mais ô combien politique d’un homme à la recherche de lui-même et d’une existence à la hauteur de ses compétences. La fin dévoile ce que nous n’osions imaginer. Il faut le voir pour le croire. Un beau travail reconnu par le Jury d’Orrizonti qui lui attribua une mention. Autre ovni et réussite absolue, Non si puo nulla contro il vento, un film de six minutes, est un pur enchantement. Merveilles et magie : les deux réalisateurs Andrea Gorla et Marco Forni font partie du groupe Flatform qui signe le film.
Peu de films osaient un happy end : celui de Saverio Costanzo — La solitudine dei Numeri primi (le livre est un best-seller en Italie) — tardait trop pour qu’on ne perde patience, même si nous étions heureux qu’il arrive. Un happy end inoubliable et spectaculaire clôt Jianyu (Règne des assassins). Après avoir croisé le fer d’une façon magistrale (Michelle Yeoh et Jung Woo Sung) et être comme morts, les deux amants ennemis ressuscitent, se pardonnent et repartent en clopinant vers une nouvelle vie. Pour nous donner un bonheur sans nuages, il n’y avait que les grands films de samurai et de kung-fu dont, en particulier, Les 13 assassins de Takashi Miike, Chen Zhen de Andrew Lau (en hommage à Jackie Chan) et un ovni fantastico-fantômatico-d’anticipation en 3D de Tsui Hark.
La seule grande surprise du festival aura été Venus noire de Abdellatif Kechiche : on espérait une revanche sur le racisme et l’exploitation du corps des femmes. Kechiche montre au contraire l’aliénation des docteurs en sciences, Georges Cuvier en particulier, en plein délire du syndrome d’infériorité des noirs (assimilés aux singes), thèse sur laquelle tous les colonialismes se sont appuyés pour mieux asservir les peuples africains. Vénus noire ou le cas de Saartje Baartman, la Vénus hottentote montrée dans les foires comme une bête féroce alors qu’elle avait l’oreille absolue, était musicienne, chantait et jouait d’un instrument. Et, en ce sens, le film est une claque à notre désir profond d’être rassuré dans notre humanité, cajolé et gâté par de belles sensations et de bonnes choses. Le film est répétitif comme les souffrances qu’elle endure. Entourée par des comédiennes et comédiens confirmés : Elina Löwensohn, Olivier Gourmet, André Jacobs et François Mathouret, Yahima Torrès (d’origine cubaine) donne une grande puissance physique et psychique à Saartje, la Vénus noire. Sa prestation réveille en nous le triste écho des Trois femmes puissantes de Marie N’Diaye.
Que l’unanimité que Il magnitismo de Tarantino, président du jury, aurait suscité (dixit Paolo Mereghetti du Corriere della sera), donne finalement un lion controversé, quoiqu’agréable à regarder Somewhere de Sofia Coppola. Peu importe : le cinéma, pas forcément celui en 3D, est quand même le grand vainqueur de cette 67e Mostra.
1. Zaijian Jiabiangou, Adieu, Jiabiangou de Yang Xianhui, Balland.
2. Still Life de Jia Zhang-ke, un autre film surprise, avait obtenu le Lion d’Or.