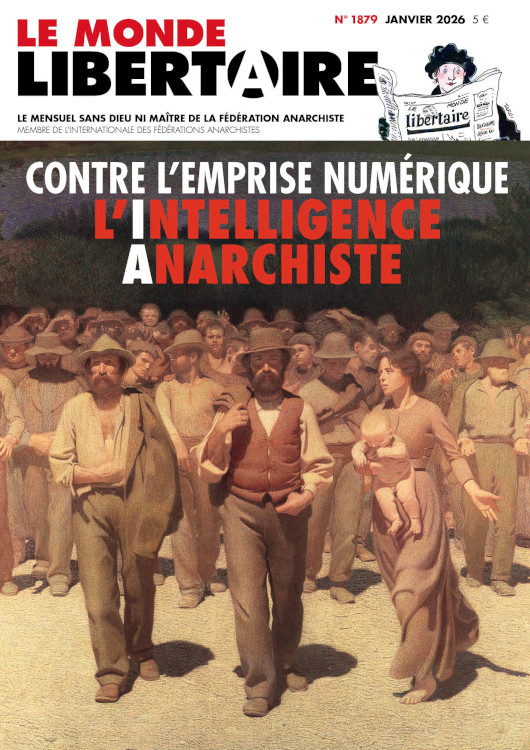Quelques films
mis en ligne le 6 juillet 2010
Peu de films marquants en cette période. J’en excepterai quatre. Dont trois qui, dans des genres différents, procèdent du même état d’esprit.Soul kitchen
De Patih Akin (France-Allemagne, 2008). Le propriétaire d’un restaurant populaire à Hambourg, vaste cantine fraternelle sans prétention culinaire, commence par perdre sa clientèle en embauchant un cuisinier qui vient d’être renvoyé d’un restau chic, pour riposte à un client. Sa cuisine raffinée déroute les habitués ; seul le revirement occasionné par un groupe de musique qui répète en ce lieu et invite ses copains au concert, ceux-ci se régalant des plats du chef, sauve l’établissement de la faillite.
À peine sorti de ce mauvais pas, le trop généreux patron se jette dans un autre, confiant le restaurant à son frère, tout juste sorti de prison, pour rejoindre lui-même sa dulcinée… qu’il découvre aux bras d’un autre !
Un ultime rebondissement rendra âme et affluence au lieu, d’une tonalité très « hippy » et « seventies », comme son tenancier, qui malgré ses déboires affectifs et un déplacement de vertèbres qui le rend à demi infirme, parvient, tout douloureux et claudicant qu’il soit, à refaire à son établissement comme à lui-même un nouvel avenir !
Un film sur l’amour humain sous toutes ses formes, sur le courage et l’altruisme, qui évoque l’inoubliable Bagdad Café.
Au même moment, à la Cinémathèque, dans la très belle rétrospective Tournages Paris-Berlin Hollywood (1910-1939), on programme Mon homme Godfrey.
Mon homme Godfrey
Cette œuvre de Gregory la Sava (États-Unis, 1939) témoigne d’une préoccupation sociale et humaniste comparable.
Le réalisateur construit son film sur l’opposition des très riches et des très pauvres. À partir d’un jeu de société où un prix fictif couronne la présentation de ce que la bourgeoisie appelle pudiquement « une personne oubliée », le loup, c’est-à-dire un clochard, est introduit dans la bergerie de luxe : ce club de loisirs perpétuels qu’est une famille de la haute, entretenue par son seul chef, où épouse et filles, maquereau parasite, domestiques en place, s’accordent à maintenir ces barrières dorées entre eux et le vrai monde – celui de la décharge où vivent Godfrey et ses copains.
L’amour (improbable) entre les représentants des deux classes fera la révolution, artificiellement aidé par la révélation de l’ancienne fortune du SDF – facilité de scénario, également idéologique.
Mais le filmage du néant des riches en vase clos, soutenu par un dialogue très brillant, est époustouflant.
Là aussi, le personnage central fait preuve d’une générosité infinie dans la misère, où il se préoccupe du sort de ses compagnons et les traite avec respect, et dans l’aisance retrouvée, puisqu’il les loge et les emploie.
La grosseur des traits ne gêne guère ; on sent dès le début qu’on est dans une sorte d’allégorie, de fable sur l’inégalité sociale –l’engagement de l’auteur aux côtés des démunis, contre un ordre monstrueux, se faisant message, voire prophétie politique.
La Tête en friche
De Jean Becker (France, 2009). Encore un joli film libertaire – notre époque aurait-elle la nostalgie de certaines aspirations ?
Il s’y agit de l’amour entre un cinquantenaire et une femme de 86 ans. Amour qui tourne autour des grandes œuvres de la littérature qu’elle lui fait connaître, puis qu’il les lui lira à son tour quand elle y verra moins clair. Germain, grâce à elle et aux grands auteurs, accomplit un saut énorme par-dessus le sentiment d’échec et d’ignorance à vie que lui ont inculqués ses maîtres et sa mère – le rapport avec ces destructeurs étant traité caricaturalement. Celui avec la mère notamment, épave alcoolique et acariâtre dont on découvrira une forme de générosité à la fin… La violence qu’elle exerce sur son fils comme sur le partenaire qui se permet de la gifler vient bien sûr de la violence subie – ce gouffre de désamour étant le versant noir du rapport édénique de Germain et Marguerite.
Tout est trop didactique, tout tourne trop bien, mais la science du jeu de Gérard Depardieu – sans doute aussi son rayonnement naturel – et ceux de Gisèle Casadessus (96 ans, on a du mal à le croire !), épaulés par les extraits de Camus, Supervielle, Romain Gary, nous rendent complices et émerveillés.
Traversée aussi par ce vent d’anarchie, la liaison entre la patronne du bar et Yousseff, de trente ans son cadet ; pan mineur, mais réjouissant, de ce beau conte.
Les Mains libres
De Brigitte Sy (France, 2009). Un très beau film par l’intensité des rapports humains et la sobriété de leur mise en scène, autour de l’amour fou entre la réalisatrice d’un film sur la prison et de l’un des détenus.
La façon de filmer toute en esquives, par plans brefs, souvent rapprochés, furtifs comme le ballet des corps intouchables dans le cadre pénitentiaire, est très efficace. On est pris dans cette fuite et ces approches risquées ; le poids carcéral est évoqué sans aucune violence (contrairement au Prophète dont on se demande encore comment il a pu faire si consensuellement illusion) : des gardiens ou des visiteurs s’éloignant de dos, derrière des grilles qui se referment les unes après les autres, et cet effleurement douloureux de ceux qui se désirent et ne peuvent même pas se parler.
Le scénario est trop chargé à mon avis : la fascination de cette belle femme cultivée pour les mauvais garçons (un dealer sidéen avant le braqueur Michel, et un indifférent avant lui) est déjà suffisamment tragique sans y rajouter la séropositivité, héritée de sa deuxième liaison.
Comme le signale le générique, ce film retrace des événements réels ayant pour cadre une centrale. Peut-être est-ce l’histoire de Brigitte Sy elle-même ? Mais la balance semble trop pencher du côté du malheur – encore aggravé par la mort brutale de Michel, un an après sa libération.
De sensibles esquisses d’amitiés féminines et d’un échange entre Barbara et le directeur de la prison où, malgré le carcan hiérarchique, de la sensibilité et de la compréhension parviennent à passer. Beaucoup d’intelligence et de lucidité dans les commentaires des prisonniers – acteurs sur le film en train de se faire – tirés d’entretiens réels.
Mais pour revenir aux détours de l’intrigue, ce travail cinématographique devait-il être abandonné à la première épreuve… même s’il ressuscite dans cette fiction ?
Un jeu très naturel, surtout celui de Ronit Elkabetz et de Carlo Brandt, en phase avec le parti-pris d’un film dans le film, et des dialogues sobres, plus chuchotés que dits quand ils cherchent à déjouer la surveillance, et du coup à peine audibles.