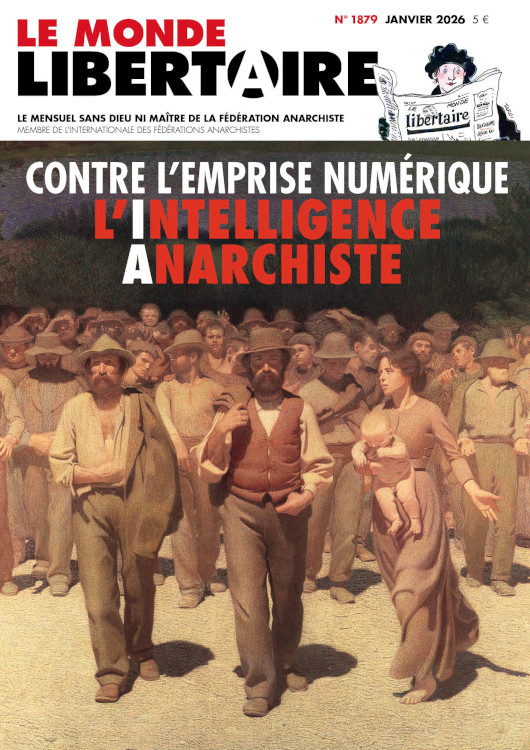Dans un sale État > Nouvelles de Kanaky
Dans un sale État

par Yewa Waetheane • le 23 novembre 2025
Nouvelles de Kanaky
Lien permanent : https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=8696

”L’indépendance de la Kanaky est un objectif politique et aussi une nécessité philosophique et éthique, visant à restaurer la dignité et l’autonomie d’un peuple qui aspire à vivre en harmonie avec son histoire, sa culture et son environnement”.
Cette phrase est de Yewa Waetheane, militant indépendantiste kanak arrêté suite à la révolte de la jeunesse à Nouméa en mai 2024, emprisonné en France avec 6 autres militants kanak, puis libéré en juin dernier avec interdiction de quitter le territoire.
Après avoir été reçu sur Radio libertaire le 22 septembre dernier (https://www.trousnoirs-radio-libertaire.org), Yewa a rédigé ce texte pour Le Monde libertaire en ligne, dans lequel il retrace plus de 170 ans de colonisation en Nouvelle-Calédonie.
Kanaky : L’État perfectionne sa colonisation
Depuis le 24 septembre 1853 (1), Kanaky subit une colonisation structurée autour de mécanismes précis, spoliation foncière, travail forcé, répression militaire, codification raciale. L’application du Code de l’indigénat en 1887 a d’abord permis d’organiser la domination par la loi, et son abolition en janvier 1946 n’a pas mis fin au système, qui s’est simplement modernisé. Dès 1956 (2), l’État remplace les outils brutaux par des statuts d’“autonomie” qui n’en sont pas, chaque texte transfère des compétences symboliques mais garde l’essentiel : la souveraineté, la justice, l’ordre public, restent sous le contrôle des institutions. Le droit interne devient l’outil principal du maintien colonial.
Droit colonial et violence d’État
Lorsque les Kanak s’organisent politiquement, Paris recentralise et lance une politique massive de peuplement pour déséquilibrer la démographie, affaiblir le vote indépendantiste et rendre minoritaire le peuple premier (3). Cette mécanique, pensée pour contourner le droit international, vise à créer une population électorale “mélangée” afin de rendre impossible une autodétermination conforme aux standards de l’ONU.
Les statuts successifs des années 70 et 80 servent la même stratégie, annoncer des avancées, neutraliser toute progression réelle. Dès qu’un texte s’approche trop près du droit à l’indépendance, il est modifié ou abandonné. Même la reconnaissance officielle du « fait colonial » en 1983 (4) est immédiatement vidée de substance. Pour rappeler qui garde le contrôle, l’État utilise alors la violence (état d’urgence en janvier 1985, "Opération Victor" action de guerre sur l’île d’Ouvéa en mai 1988).
Accords de Matignon, autonomie sous tutelle
Le référendum boycotté de 1987 (5) illustre une autre mécanique, le droit interne organise un simulacre démocratique pour fabriquer la légitimité coloniale. Les Accords de Matignon en juin 1988 encadrent une autonomie sous tutelle, où tout transfert de compétence dépend de l’État, constitutionnellement garantie dans les articles 76 et 77. En enfermant Kanaky dans un cadre constitutionnel français, Paris s’offre un bouclier juridique, tout droit international relatif au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes passe après la Constitution, ce qui permet à l’État de contourner de manière légale l’esprit de la décolonisation tout en respectant “formellement” ses propres lois. Les effets pervers sont clairs, une démographie manipulée pour étouffer la majorité autochtone, institutions sous contrôle, référendums biaisés, autonomie limitée, et impossibilité d’un choix souverain. Le droit interne sert à légitimer la domination, tandis que le droit international est neutralisé par des mécanismes constitutionnels. La colonisation change d’outils, mais pas d’objectif c’est d’empêcher le peuple kanak d’exercer pleinement son droit à l’autodétermination.
Accord de Nouméa, "gel électoral"
Avec l’accord de Nouméa (6), l’État semblait reconnaître le droit du peuple kanak à l’autodétermination, mais il verrouille aussitôt le processus en constitutionnalisant les règles du jeu, transferts conditionnés, référendums encadrés par Paris. Le gel électoral (7) n’est pas un “cadeau”, c’est le minimum pour empêcher que la politique de peuplement menée depuis la colonisation ne transforme la consultation en farce coloniale. Mais même ce mécanisme, pourtant destiné à protéger les victimes de l’Histoire, devient aujourd’hui une cible ainsi l’État cherche à le déverrouiller pour redonner du poids électoral à une population importée, reconfigurée, fabriquée par un siècle de colonisation démographique. Le troisième référendum du 12 décembre 2021 est imposé malgré la demande unanime de report des autorités coutumières, les familles kanak ayant besoin d’une période prolongée de deuil en raison de la pandémie de Covid-19. Cela montre comment le droit interne devient un instrument pour contourner le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le calendrier décidé unilatéralement ne prend pas en compte les us et coutumes ainsi l’absence du peuple premier dans l’isoloir (56 % d’abstentions) conduit à “clore le dossier”. Paris a utilisé son propre cadre juridique pour produire un résultat contraire à l’esprit de la décolonisation tout en prétendant respecter le cadre légal.

"Accord" de Bougival, ingénierie démographique
L’accord de Bougival du 12 juillet 2025, rejeté par le FNLKS le 13 août, s’inscrit dans la même logique. Présenté comme une “sortie du cycle référendaire”, il est en réalité un outil pour réintroduire l’ingénierie démographique dans le droit institutionnel. En ouvrant définitivement le corps électoral, il annule l’un des seuls mécanismes protecteurs encore existants et prépare une Nouvelle-Calédonie où le vote kanak sera à nouveau minorisé, non pas par choix politique, mais par décision constitutionnelle. L’État utilise ici la force de son droit interne pour neutraliser un principe : le droit international à l’autodétermination. Bougival permet ainsi à Paris d’habiller cette manœuvre en une “modernisation démocratique”, alors qu’il s’agit clairement d’un retour aux outils coloniaux classiques : contrôler les institutions, redéfinir qui a le droit de voter et créer une majorité électorale artificielle favorable au maintien dans la République.
Le FLNKS, partenaire historique des accords précédents, refuse d’y adhérer car il voit précisément ce qui se joue, une confiscation de la souveraineté par des mécanismes constitutionnels, rendant l’indépendance juridiquement inaccessible. Ainsi, par la voie du droit interne, l’État contourne la décolonisation prévue par l’ONU et reconstruit un statut où Kanaky reste française non pas par choix populaire, mais par architecture juridique. Ce que Paris ne peut plus imposer par la force, il le verrouille par le droit interne, redéfinir qui vote, quand on vote, comment on vote, modifier la démographie pour fabriquer une majorité ainsi utiliser les référendums comme armes et bloquer l’autodétermination derrière des articles constitutionnels pour présenter la manipulation comme “dialogue” notamment l’ingénierie coloniale comme “réforme”, et la confiscation de la souveraineté sincère comme “paix”. Bougival n’est que l’ultime expression de cette stratégie, neutraliser le peuple kanak, contourner le droit international, et maintenir Kanaky française non par volonté du pays, mais par architecture juridique. Il faut le dire sans détour tant que Paris décidera qui compte comme citoyen, qui peut voter et dans quel cadre se joue l’avenir du pays, Kanaky restera prisonnière d’un dispositif pensé pour durer. Sous ses habits juridiques, la France ne met pas fin à la colonisation, elle la perfectionne.
Face à cette mécanique froide, un fait demeure, têtu, inaltérable, aucun peuple n’a jamais renoncé à son droit à l’existence politique.
Le peuple kanak ne demande pas la permission de devenir souverain, il rappelle simplement à la France qu’aucune architecture juridique ne pourra effacer sa légitimité, ni étouffer indéfiniment sa marche vers l’indépendance.
Yewa Waetheane
Notes
(1) Le contre-amiral Febvrier-Despointes prend possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de l’empereur Napoléon III. Une colonie pénitentiaire y est installée l’année suivante.
(2) 23 juin 1956 : la loi-cadre de Gaston Defferre crée une assemblée territoriale et un conseil de gouvernement local.
(3) En 1972, le Premier ministre Pierre Messmer prône diverses mesures afin d’éloigner le danger d’une "revendication nationaliste des populations autochtones en améliorant le rapport numérique des communautés" : "immigration massive de citoyens français métropolitains", "immigration systématique de femmes et d’enfants", "réserver des emplois aux immigrants dans les entreprises privées".
(4) Juillet 1984 : la table ronde de Nainville-les-Roches reconnaît aux Kanak un « droit inné et actif à l’indépendance » et évoque la notion de « victimes de l’Histoire ».
(5) La condition pour y participer étant de seulement 3 ans de résidence, les indépendantistes appellent au boycott : sur 50,1 % de votants, 98 % favorables à rester dans la République française.
(6) 5 mai 1998 : l’État français transfère des compétences en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des domaines de la défense, de la sécurité, de la justice et de la monnaie.
Un référendum sur l’indépendance est prévu, suivi d’un second puis d’un troisième en cas d’échec de celui qui précède.
(7) Sont électeurs les résidents en Nouvelle-Calédonie avant 1998, ainsi que leurs descendants, à la condition de résider préalablement pendant dix années consécutives sur le territoire
PAR : Yewa Waetheane
SES ARTICLES RÉCENTS :
Réagir à cet article
Écrire un commentaire ...
Poster le commentaire
Annuler