Littérature > Le rat noir ne manquera pas à l’appel de juin
Littérature

par Patrick Schindler • le 30 mai 2022
Le rat noir ne manquera pas à l’appel de juin
Lien permanent : https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=6528

Note de la rédaction : Un remerciement fraternel à Patrick pour cette chronique passionnante. L’équipe du comité de rédaction va céder sa place à une nouvelle. Alors prenons le temps de partager un café en souhaitant bon vent au rat noir.
.jpg)
En ce mois de juin, le Rat noir vous propose de revisiter les « pensées cyniques de Diogène ». Découvrir L’aveugle et sa chandelle de Tassos Livaditis et fouiller dans Le fond de la poche droite de Yannis Maridakis. Puis, l’Italie avec trois romans d’Erri de Luca. Petit arrêt dans la France des collabos avec L’inspecteur Sadorski libère Paris de Romain Slocombe. Nous suivrons ensuite James Baldwin dans La chambre de Giovanni. Viendront Les Catastrophes de Patricia Highsmith avant d’achever ce voyage dans l’Angleterre-Caraïbe avec Fille, femme et autre de Bernardine Evaristo.
« Semblable à un champ de la Grèce qui n’offre plus que des ruines et des noms touchants »
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie
Diogène le Cynique : pensées et anecdotes
.jpg)
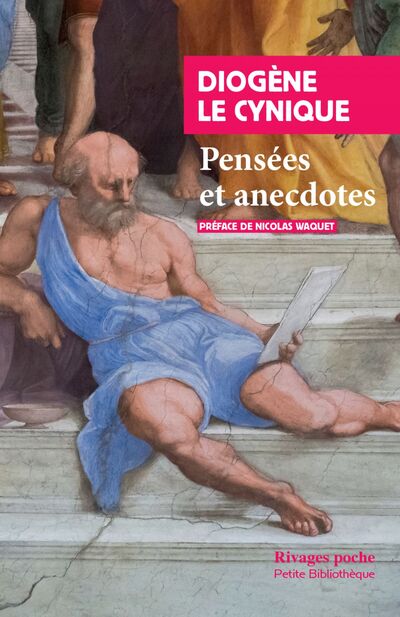
La première propose une biographie de Diogène établie selon plusieurs sources « Cet homme sans cité, sans foyer, privé de sa patrie, mendiant vivant au jour le jour, l’exemple parfait du sage » qui, selon Diogène de Laërce « commença par appliquer ses leçons de l’ascèse sur lui-même ». Diogène pour lequel « L’école d’Euclide respirait la bile, les cours de Platon étaient une perte de temps, les concours des Dionysies de vastes attrape-nigauds et les démagogues, des valets du vulgaire ». Rien de moins.
Mais, combien savoureuses sont les anecdotes rapportées par Diogène de Laërce au sujet de Diogène le Cynique. Certaines furent cependant parfois attribuées à d’autres philosophes de ses contemporains, comme Théodore l’Athée, etc. Comment ne pas en citer quelques-unes pour la bonne bouche ? Lorsqu’un jour, un homme lui lance : « Les habitants de Sinope t’ont condamné à l’exil. », Diogène répond : « Eh bien moi, je les ai assignés à résidence !» !Quand on lui demande quelles sont ses origines, celui-ci répondait « Je suis citoyen du monde ». Pourquoi il faisait l’aumône aux mendiants et pas aux philosophes, il répliquait : « Parce que les gens s’attendent à devenir aveugles ou boiteux, mais jamais philosophes ». Un jour qu’il se masturbait sur l’agora, il lança « Ah ! si seulement on pouvait aussi calmer la faim en se frottant le ventre » …
Dans une autre partie du livre, Sur la vertu, Sur la tyrannie et Le discours isthmique, Dion Chrysostome, développe longuement ce en quoi consistait la vertu pour Diogène. Entre autres : « Le rejet de tous les biens de valeur et tous ceux que l’on gagne au prix d’un harassant labeur ». A l’exemple des oiseaux migrateurs, Diogène prônait de « changer de région au gré des saisons, de respecter son corps et la nature en observant un régime strict et réduit au minimum vital » et surtout, « d’attendre d’avoir faim et soif pour se nourrir ». Aux Jeux isthmiques, Diogène approchant un Athlète qui se vantait d’avoir remporté le prix du stade, il l’apostropha : « Et alors ? Ce n’est pas parce que tu as devancé tes concurrents que tu es plus intelligent pour ça. N’as-tu pas honte de te vanter d’une chose que les bêtes les plus viles font mieux que toi, une chose qui est dans leur nature. Chez les fourmis aussi, les unes sont plus promptes que les autres, les admire-t-on pour cela ? »
Dans sa conception de la vertu, Diogène met surtout l’homme en garde contre son pire ennemi : le plaisir, qui « après avoir dominé et possédé ses victimes, les livre aux peines les plus odieuses, les plus insupportables ». Il critique les éphèbes indolents.
Pour conclure le chapitre, Dion Chrysostome cite encore quelques perles attribuées au philosophe et entachées de son franc-parler légendaire. Pour n’en citer qu’une, Diogène déclarait que « les poissons se montrent presque plus sages que les hommes lorsqu’ils ont besoin d’éjaculer : ils sortent simplement de leur retraite pour se frotter contre quelque chose de rugueux » !
Un petit volume à déguster avant votre prochain départ en Grèce !
Tassos Livaditis, L’Aveugle et sa chandelle
.jpg)
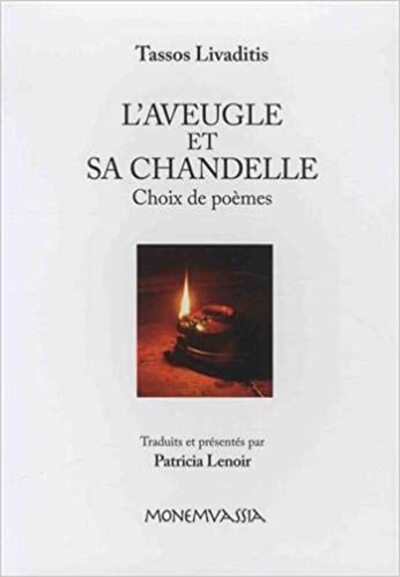
Comme nous l’explique Patricia Lenoir, arrivé à l’âge de cinquante ans, après toutes ses années de militance et de prison, « orphelin du rêve révolutionnaire sans pour autant renier ses idéaux », Livaditis continue à publier des textes dans les années 70/80 [note]. Ces derniers reflètent les désillusions de toute une vie, mais n’en laissent pas moins deviner une vision élargie par l’expérience.
Son recours pour sécher les plaies, autre que l’apitoiement ? « Changer le réel, l’enluminer, quand bien même celui-ci n’est pas toujours rose ».
De fait, ses poèmes ou proses sont-ils vraiment des poèmes ? On est en droit de se poser la question. On peut les considérer comme des « scénettes », autant de bribes de romans qui au premier regard pourraient paraître « sans queue ni tête » [note] mais à y mieux regarder, il s’en dégage une indéniable cohérence empreinte d’une grande lucidité. Ainsi de la poésie « Telle une grande vérité que l’on découvre des années plus tard quand elle ne peut plus servir à rien » ! La plupart de ses poèmes se déroulent en automne ou en hiver. Aux heures « entre chien et loup ». « Le soir tombait et je restais là, fasciné, devant tant de justice cachée ». Ils mettent en scène des pauvres des clochards et des ivrognes, aux heures où : « Les âmes des ivrognes tournent comme des mouches dans les verres vides.» Ils évoquent également ces fous « qui distraient les enfants qui ne veulent pas grandir ». Les amours louches « Dans la rue des hôtels borgnes, où les femmes de chambre entendent tant de soupirs d’amour qu’elles oublient de vieillir ». Des morts qui « se rassemblent le soir derrière les miroirs […], s’installent et veillent dans notre sommeil tandis qu’il nous faut dormir pour eux ». De son père qui lui disait « Souviens-toi de moi, sinon je serai mort deux fois. » …
Le chant de Tassos Livaditis rayonne parmi les êtres décalés, désespérés, relégués « Ceux que l’on fait manger à la cuisine, qui essuient soigneusement leur assiette comme s’ils effaçaient enfin leurs dernières traces ».
Le regard qu’il pose sur la religion est très personnel, ainsi nous raconte-t-il qu’une vieille lui expliqua un jour pourquoi le christ était ressuscité « Parce qu’il avait peur qu’autrement on l’oublie » !
L’atmosphère de son œuvre peut parfois sembler pesante mais jamais accabler. Quelques petites phrases, pêchées ci et là : « Je n’avais d’autre issue que le tapis, que je pliais peu à peu de telle sorte que le pire ne se voit pas » / « Les oiseaux voyagent au printemps, les arbres sont leurs bagages » / « Je me suis assis au bout de la route, si triste que les aveugles me voyaient ».
Parmi les poèmes qu’il dédie à ses amis, celui dédié à Constantin Cavafis : « Nuits dissolues, alcool, étreintes effrénées, plaisirs géants comme les coupoles d’un temple. […]. Puis au matin, il rentrait seul, épuisé, plus mûr et rapportant, nouvelle innocence, l’impur nouveau poème ».
Tassos Livaditis pour lequel : « Les plus beaux poèmes ne sont jamais écrits » …
Yannis Makridakis Au fond de la poche droite
.jpg)
.jpg)
Ultime occasion pour Vikentios de pouvoir enfin « vider son sac » ?
Ce livre raconte l’histoire simple d’un homme vivant au rythme de la nature. Se contentant du stricte minimum. Yannis Makridakis nous introduit au cœur de la morne vie de moines isolés dans leurs bunkers. Dont la seule mission est de souffrir !
Et c’est réussi ! Un livre qui montre combien nombre de Grecs, encore aujourd’hui restent accrochés à des coutumes ancestrales, pouvant paraitre dérisoires aux yeux des athées et qui représentent pour les premiers (avec leur langue), le soi-disant « ciment d’un peuple » ! Simple constat ? Critique subjacente ? A vous de juger !...
Trois romans d’Erri de Luca
.jpg)
Le tort du soldat
.jpg)
Passionné par cette langue, il accepte et part dans la région montagneuse des Dolomites (pré-alpes italiennes) pour y écrire dans le calme. Installé dans une auberge fréquentée par des touristes autrichiens et allemands, tandis qu’il a étalé devant lui des feuilles écrites en yiddish, un père accompagné de sa fille germanophones, s’assied à la table voisine. Tandis que celui-ci aperçoit les papiers du narrateur, il se lève brutalement et quitte précipitamment le café, suivi par sa fille rétive.
C’est cette jeune fille qui, dans la seconde partie du roman, prend la plume pour nous raconter l’histoire de son père, ancien soldat de la Wehrmacht ayant échappé aux procès, que tout oppose à elle. Elle évoque alors son enfance passée en Autriche dans la clandestinité et l’ennui. Ayant à subir un père paranoïaque qui après avoir été quitté par sa dernière femme, se renferme dans son passé, restant fidèle aux préceptes nazis. Jusqu’à l’obsession.
De digressions en digressions, (art particulier dans lequel Erri de Luca excelle), nous comprenons vers où le narrateur veut nous mener en nous faisant remonter le temps jusqu’à la fameuse scène du début du roman.
De la grande littérature qui indique aux jeunes générations qu’elles auraient tort de refouler une période de l’histoire qu’elles devraient plutôt chercher à approfondir.
Le tour de l’oie

Une fois encore, Erri de Luca va de digressions en digressions, nous parler de la Naples durant la seconde guerre mondiale, de son passé de militant dans l’Italie des années 70, et de son expérience durant la guerre de Bosnie, tandis qu’il s’était engagé dans une association humanitaire.
Il va encore raconter à ce fils fictif, ses premières amours. Puis avant de disparaitre, c’est le fils qui prend la parole et mène le jeu.
Discussion à bâtons rompus, au hasard de dés jetés, comme dans un Jeu de l’oie, soumis aux désidératas aux aléas. Au sujet de tout et de rien : peinture, littérature, Jacques Brel, dialecte napolitain et bien sûr, les grandes passions de de Luca : étoiles et escalade en montagne. Et d’un passé « en forme de Ciambella [note] ». Véritable régal des sens. Petites phrases que l’auteur nous tend, « scintillantes comme certaines étoiles, tandis que d’autres s’éteignent, tout comme la vingtaine de langues qui meurent chaque année dans le monde ».
Impossible
.jpg)
Meurtre ? Car il s’avère au cours de l’enquête, que les deux protagonistes n’étaient pas des inconnus, qu’ils avaient été tous les deux militants du même groupe révolutionnaire dans les années 80.
Au cours de l’intrigue, menée d’une main de maître, nous allons en apprendre bien d’autres.
Car, l’art d’Erri de Luca consiste à prendre son lecteur par la main pour lui faire recracher le passé, tout comme le fait le jeune magistrat qui interroge le suspect. Le récit se transforme alors en une espèce de lutte entre chat et souris. Mais qui est le chat et qui la souris ?
De rebondissement en rebondissement, un interrogatoire « magistralement » bien ficelé !
Romain Slocombe : L’inspecteur Sadorski libère Paris
.jpg)
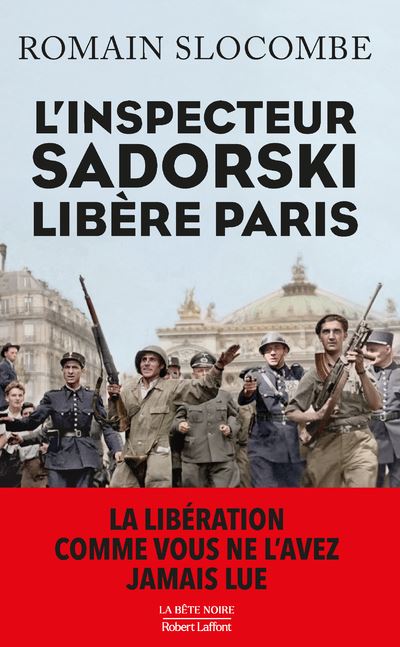
En matière de propos immondes, nous allons être servis !
Suit en effet dans la préface, la reproduction d’un article paru dans le quotidien Le Matin le 25 juin 1944, condamnant l’assassinat de Philippe Henriot, figure majeur de la collaboration avec les nazis, alors que les troupes alliées sont déjà entrées dans la ville de Caen ! C’est dans ces circonstances que nous faisons la connaissance de l’inspecteur Sadorski, personnage rébarbatif s’il en est, « homme d’ordre et policier par vocation », qui cumule racisme, antisémitisme, homophobie et sexisme. Après avoir été accusé par une femme jalouse d’appartenir à la Résistance et après avoir été torturé par la Gestapo, il croupit depuis huit mois dans la sordide prison de la Santé. Jusqu’à ce, convoqué par le directeur de la prison, convaincu de son innocence et de ses « bons services dans la police de Vichy », lui propose la liberté contre sa participation à une mission très particulière. Il s’agit, déguisé en officier nazi de la SD, de servir de « caution morale allemande » dans le transfert d’un haut personnage de l’état, ancien ministre juif. Celui-ci devant être livré sain et sauf aux autorités de Vichy, afin que celles-ci ne décident de son sort. Prêt à tout pour sauver sa peau, Sadorsky accepte le deal.
Nous entrons alors dans le monde très fermé d’un petit groupe de miliciens, formé de petites frappes et de têtes brûlées. L’un d’eux « pète un plomb » et abat froidement l’otage. Consternation dans le convoi : comment vont réagir les nazis et comment réagira le gouvernement de Vichy ? Mais surtout comment Sadorski va-t-il se sortir de cette situation fâcheuse ? Et si réhabilité dans ses fonctions, c’était justement à lui que l’on confiait la tâche délicate de retrouver le milicien coupable de l’assassinat ? Alors, jusqu’où ira l’immonde inspecteur Sadorski pour mener à bien son enquête ?
Voilà pour l’intrigue qui nous fait mettre un pied au plus profond de la France collaboratrice. Police corrompue, bourgeoisie acoquinée avec les occupants, maquereaux et pègre.
Une affaire basée sur un fait réel s’étant déroulé en juin 44, et dont encore aujourd’hui, tous les mobiles n’ont pas été établis. En attestent tout au long de ce récit romancé, les nombreuses références citées et sourcées dans les notes de bas de page.
Le roman évoque ensuite la progression des forces alliées vers Paris, les manifestations organisées par les communistes auxquelles finissent par se ranger quelques policiers municipaux, lorsque le vent commence sérieusement à tourner.
Arrivés dans cette seconde partie du livre nous allons assister aux nombreux retournements de vestes. L’inspecteur Sadorski, ancien policier de la brigade « antijuive » en sera. Comment dans ce nouveau contexte se refera-t-il une virginité ? Réussira-t-il à faire le grand écart ?
Pages troublantes qui retracent ces années consternantes restituées par Romain Slocombe dans toute leur cruauté, leur grossièreté et leur ignominie.
Sommes-nous seulement sûrs qu’aujourd’hui le ventre de la bête immonde a cessé d’être fécond ? …
James Baldwin : La chambre de Giovanni
.jpg)
.jpg)
Au fil de ses souvenirs, David arrive au jour où Hella a décidé de faire un voyage en Espagne avant de s’engager plus avant dans leur relation. C’est alors qu’il a rencontré Giovanni, serveur de charme italien, « élément très décoratif » d’un bar interlope. Contre toute attente : c’est le coup de foudre. Partagé entre fascination et appréhension, David accepte l’invitation dans sa chambre après une nuit de beuverie. C’est l’escalade. Ou plutôt, la descente dans les « gouffres de la passion ». Ecartelé entre deux flammes, qui choisira David, Hella ou Giovanni ? Dilemme infernal, fatal.
On peut imaginer le choc que provoqua la publication de ce roman dans les années 50, au style unique à l’énergie envoûtante, irrépressible.
Patricia Highsmith : Catastrophes
.jpg)
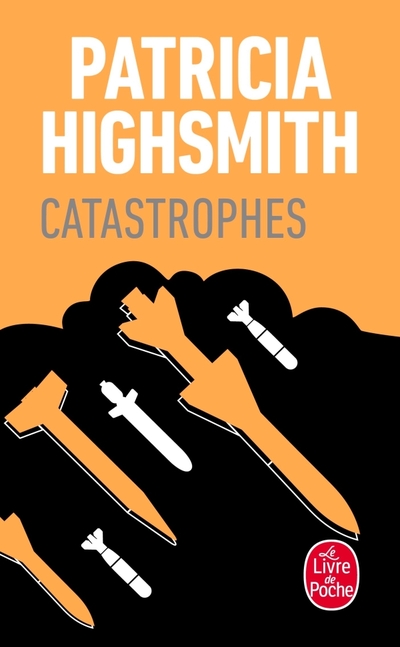
Dans la première, les médecins d’une petite ville d’Autriche expérimentent des injections sur des cadavres de cancéreux à titre d’expérience. Que va-t-il se passer lorsque l’on va découvrir qu’ils produisent des excroissances vivantes ?
La nouvelle suivante nous propose de savoir comment une baleine se transforme au cours de sa folle aventure en « torpille vivante » !
Plus loin, comment des cafards « géants hyper fertiles » envahissent un immeuble de luxe texan de 88 étages, et vont finir classés « catastrophe naturelle » …
Encore : que va devenir le Nabuti, petit pays d’Afrique de l’Ouest, une fois laissé à son indépendance et passé sous le contrôle d’un roi aussi fou que son peuple ?
Ailleurs : que vont devenir ces malades mentaux et prisonniers une fois lâchés dans la nature par une circulaire gouvernementale ayant pour objectif de soulager les dépenses publiques ?
Aussi : dans quelles circonstances un agent chargé de prévenir les négligences dans le traitement des déchets atomiques va se retrouver enfermé dans un centre de stockage ?
Comment une manifestation opposant des mères porteuses opposées et des fondamentalistes anti-insémination et anti-IVG va-t-elle s’achever ?
A quoi peut bien ressembler une femme âgée de cent-quatre-vingt-dix ans maintenue en vie dans une maison de retraite américaine ?
Comment un pape durant son voyage en Amérique du Sud peut être amené contre toute attente, à prononcer un discours de lutte des classes et de libération sexuelle ?
Comment un président des Etats-Unis pourrait-il s’en sortir après que la presse a eu découvert que malgré ses engagements, il a vendu des armes à deux antagonistes du Moyen-Orient ? Surtout si celui-ci est accompagné d’une femme alcoolique et incontrôlable !
Dix thèmes Highsmithien par excellence qui évoquent une panoplie de problèmes sociétaux, traités avec un cynique noir ou irrésistible, selon les cas ...
Bernardine Evaristo : Fille, femme et autre
.jpg)
.jpg)
Tout d’abord Amma, qui a réussi l’exploit après bien des embuches, de s’imposer en tant que première metteur en scène noire, au prestigieux Théâtre National de Londres. Nous sommes le soir de la Première de son dernier spectacle. Celui-ci évoque une épopée qui se déroule dans le Dahomey au début du 19ème siècle, au temps où des guerrières, « dernières amazones », étaient au service du roi pour combattre ses ennemis et les colons. Comment la critique londonienne va-t-elle recevoir cette pièce au propos provocateur ?
Amma y a invité toutes ses relations, ainsi que Yazz, sa fille. « Fille d’une mère lesbienne polygame et d’un père gay narcissique » qu’elle a eu par insémination artificielle. Yazz qui, une génération plus tard, se définit comme « activiste non binaire ».
Yazz, a elle invité, le groupe de ses amies de sa fac de Lettres « Les imbaisables, en perpétuelle recherche de discours sur les inégalités raciales et sexuelles » !
Amma a également invité le père génétique de Yazz, une caricature du bobo homo londonien.
Sont également présentes, les amies d’Amma originaires comme elle du quartier HLM de Pekham qu’elle a connues durant « les années Thatcher ».
A commencer par Dominique, sa complice de toujours avec laquelle elle a vécu de communauté en communauté, de squat en squat dans les milieux underground londoniens. Dominique qui un jour s’est fait enlever par une afro-américaine « radioactive-séparatiste lesbienne et végan », qui l’a enchaînée dans une communauté de femmes de l’autre côté de l’Atlantique.
Carole. Jeune Nigériane, violée à l’âge de treize ans qui a réussi, quitte à renier sa différence sociale et sa couleur, à s’imposer dans le milieu des « winners » : les banquiers de la City.
Bummi, la mère de Carole. Femme de ménage qui a réussi à monter son entreprise à la force du poignet.
Autre invitée : Mrs King, leur professeur de collège qui les a poussées à croire en elles. Miss King : fille-mère, trois ménages ratés, trois gamins. En suivant son parcours nous allons également faire la connaissance de sa mère, Winsome, conductrice de bus, originaire de la Barbade et arrivée dans le Londres raciste des années 20, qui en a vu de toutes les couleurs !
Latisha, une autre ancienne amie de Carole d’origine caribéenne, parvenue au grade « chef du rayon fruits et légumes dans un supermarché » après bien des péripéties et pas des plus drôles.
Et encore, Pénélope, Morgan, etc.
Nous allons toutes les retrouver réunies dans la dernière, apothéose du livre. Petit monde hétérogène qui, selon les cas vont se tomber dans les bras ou s’esquiver ou carrément disparaitre. Chant polyphonique aux accents de vécu ? Fresque grandiose, en tous cas !
Patrick Schindler, individuel FA Athènes
PAR : Patrick Schindler
individuel FA Athènes
individuel FA Athènes
SES ARTICLES RÉCENTS :
Rat noir, entre deux juins tu pourrais faire que’que chose !
In July with the library’s black rat
Rat noir, entre deux juins tu pourrais faire que’que chose !
In July with the library’s black rat
Réagir à cet article
Écrire un commentaire ...
Poster le commentaire
Annuler




