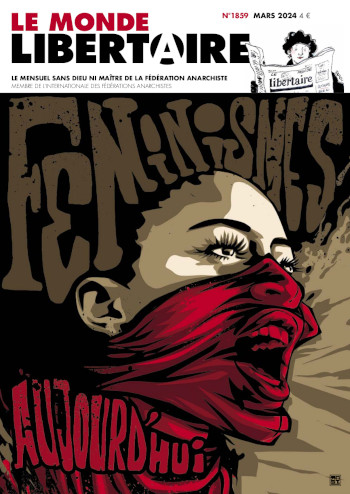À la recherche d’un vieil Antonio
mis en ligne le 25 septembre 2013
Il y a quatre façons d’assister à la Petite école zapatiste : se rendre dans une communauté et un caracol pendant une petite semaine ; assister aux cours « magistraux » au Centre indigène de formation intégrale (Cideci, dit aussi université de la Terre), à San Cristóbal de Las Casas ; suivre les enseignements par vidéoconférence ; ou, simplement, commander les quatre manuels et les deux DVD pour travailler tout seul dans son coin. Bien que pas forcément les plus accessibles, les deux premières modalités sont assurément les plus intéressantes puisque, outre les quelques cours « magistraux », chaque élève est confié aux bons soins d’un compa zapatiste, lequel est chargé de veiller sur lui et de répondre à ses questions. Appelés votán ou gardiens, ces « veilleurs » sont des interlocuteurs et des intermédiaires précieux pour nous permettre, à nous élèves, d’entrer de plain-pied dans le zapatisme.
Pour ma part, j’avais opté, lors de mon inscription en mars, pour le « séjour dans une communauté et un caracol », la seule permettant de s’immerger dans la vie quotidienne des zapatistes au sein même de leur territoire. Et c’est ce séjour que je vais maintenant relater dans cet article, jour après jour… La relativement longue narration à la première personne du singulier qui va ainsi suivre peut sembler entrer en contradiction avec tout ce qui me sera enseigné pendant la Petite école sur l’importance du « nous » et du travail collectif. Mais, à la fin de cette semaine scolaire un peu particulière, mon votán insistera beaucoup pour que, à mon retour en France, je relate cette expérience, histoire de donner à mes « concitoyens » une idée de ce qu’est la vie des zapatistes et de ce que fut cette première session de la Petite école zapatiste. Alors, je me plie à l’exercice. Je fais mes devoirs, en quelque sorte…
Enregistrement et départ
Le dimanche 11 août, la fête des caracoles laisse place aux préparatifs de la Petite école. L’enregistrement des étudiants se fait au Cideci, dès 10 heures. La vaste enceinte de l’établissement est bondée, des personnes de tous les horizons (bien que principalement en provenance du District fédéral) attendent patiemment leur tour dans de longues files d’attente. Nous sommes répartis en deux groupes : d’un côté ceux qui suivront les cours au Cideci, de l’autre ceux qui iront dans les communautés (eux-mêmes divisés en deux files, une pour les nationaux et une pour les internationaux). L’organisation semble au top et, malgré le monde, je n’attends mon tour pas plus de trois quarts d’heure. On me remet les manuels (il y en a quatre : Autogobierno I, Autogobierno II, Resistencia autónoma et Participación de las mujeres) et une carte d’étudiant indiquant mon « affectation » au caracol III, dit « Résistance jusqu’à un nouveau lendemain », situé dans la zone tseltal de La Garrucha. S’ensuit une attente, beaucoup plus longue que la précédente, celle du départ. Les élèves des caracoles Roberto Barrios et La Realidad, les plus éloignés de San Cristóbal de Las Casas, partent les premiers, dans de petits combis appartenant aux Transports autonomes zapatistes. Les « Garruchiens », dont je fais donc partie, viennent ensuite. Nous sommes répartis dans des bétaillères, un vieux bus scolaire et deux vans. Par chance, j’échappe aux bétaillères (qui nécessitent de voyager debout) et j’obtiens une place – confortable – dans l’un des deux vans, lesquels avaient été loués par des camarades américains de Chicago. La répartition prend une bonne heure, après quoi la caravane ainsi constituée (dix-sept véhicules !) s’ébranle et prend la route du caracol.
En 2011, le trajet jusqu’à La Garrucha, depuis San Cristóbal de Las Casas, n’avait pas duré plus de cinq heures. Il en prendra presque le double cette fois-ci, la caravane étant beaucoup plus lente : les véhicules s’attendent les uns les autres, quelques pauses et une crevaison. Heureusement, tout le monde est de bonne humeur et le voyage passe finalement plutôt vite. Mon van ne compte que des Mexicains, excepté le chauffeur (un Américain), la plupart en provenance du District fédéral. Plusieurs militent au sein d’une mouvance anarchiste mexicaine aux contours assez vagues, davantage faites de petits collectifs – essentiellement punks – que d’organisations à proprement parler. Nous échangeons autour de nos activités militantes et des situations politico-sociales de nos pays respectifs. Partis vers 16 heures, c’est à minuit que nous arrivons devant l’entrée du caracol. Commence alors une longue attente de deux heures avant de pouvoir entrer, les zapatistes notant soigneusement le nom, le pays et la ville de chacun des trois cents étudiants. En outre, les véhicules entrent un par un, avec des pauses de cinq à dix minutes entre chaque. On comprend vite pourquoi : chaque camion a droit à son accueil avec musique et consignes de bienvenue. Quand notre tour arrive (vers 2 heures), je me rends compte de l’ampleur de l’événement : des centaines de zapatistes forment une allée et applaudissent les élèves qui la traversent en criant « ¡Viva los alumnos y las alumnas ! ». De quoi nous émouvoir.
Après un chaleureux discours de bienvenue, on nous apprend qu’un repas nous attend, suivi… d’un bal ! En l’apprenant, on rigole… C’est qu’on est nombreux à n’attendre qu’une chose : se coucher, peu importe où, mais se coucher. Mais on ne va pas refuser une fête de bienvenue !
Premier jour d’école
Levé à 7 heures, après une (courte) nuit très en musique et un sommeil très relatif, allongé sur un banc métallique. Petit-déjeuner à base de café, de tortillas et de frijoles, le corps assailli de bâillements. À 7 h 30, alors que des centaines de zapatistes (hommes et femmes, le visage dissimulé derrière un passe-montagne ou un foulard) forment quatre grandes files devant le templete du caracol (une par commune autonome), on nous demande, à nous les élèves, d’en faire autant sur le terrain de basket à côté. On comprend vite de quoi il va s’agir : donner à chaque étudiant son fameux votán.
Le mien s’appelle José Martínez (il s’agit de son nom de lutte) et, derrière son passe-montagne, je devine le visage d’un homme en fin de quarantaine (j’apprendrai par la suite qu’il a, en fait, 56 ans). On se salue plus ou moins timidement et nous échangeons quelques banalités pour créer le lien. À partir de ce moment-là, et comme l’avaient exprimé les communiqués précédant la Petite école, nous ne nous lâcherons plus : mon votán est là pour me guider, m’épauler, répondre à mes questions et m’héberger ; bref, il est là pour être aux petits soins (non comme un serviteur, bien sûr, mais comme un camarade, un compa). Et il l’est, aux petits soins. Et si je lui pose bon nombre de questions, il s’intéresse aussi à qui je peux bien être. C’est ainsi l’occasion, pour moi, de lui expliquer ce qu’est la Fédération anarchiste (dont il s’étonnera du faible nombre d’adhérents) et de tenter de décrire les différentes zones géographiques de la France.
Ces premiers échanges passés, les cours « magistraux » sont annoncés et les trois cents élèves, chacun accompagné de son votán, se rassemblent sous une grande structure en bois couverte d’un toit de tôle. Assis face à nous, devant le drapeau national mexicain et celui de l’EZLN, se trouvent nos professeurs (maestros et maestras), au nombre de dix-huit (si j’ai bien compté). Chacun leur tour, ils interviendront sur un thème précis. L’explication du projet d’autonomie et du fonctionnement de l’autogouvernement occupe une bonne partie des trois heures de cours. Outre les interventions des professeurs, un vaste schéma de plusieurs mètres de haut et de large nous est présenté pour qu’on y voie un peu plus clair. Ils insistent beaucoup sur les trois niveaux du gouvernement autonome : le gouvernement local (la communauté), le municipio autonome (la commune, qui regroupe des communautés) et le caracol (où siège le Conseil de bon gouvernement, qui regroupe des communes). Les décisions se prennent et s’appliquent via ces trois niveaux, non sans être préalablement débattues, discutées, amendées. Car, si les propositions semblent généralement venir des élus (lesquels sont élus en assemblée et révocables), elles ne manquent jamais de redescendre les différents niveaux de gouvernement jusqu’à la base : la communauté. Ainsi, par exemple, un projet envisagé par le Conseil de bon gouvernement d’une zone du territoire zapatiste est, avant toute prise de décision, présenté aux assemblées et aux autorités des communes autonomes, puis à celles des communautés. Une fois ces différents niveaux consultés, le projet remonte au Conseil de bon gouvernement qui, selon ce qu’en auront dit les assemblées et les élus, l’appliquera tel quel, le modifiera (auquel cas il redescendra à nouveau jusqu’à la communauté) ou en abandonnera l’idée. Il y a donc un ascenseur permanent qui garantit la souveraineté de la base, sans laquelle on ne pourrait parler ni d’autonomie ni d’autogouvernement.
La question féminine a également fait l’objet de plusieurs interventions et occupé une place importante. Car, si la condition des femmes a fait des progrès conséquents dans les communautés indigènes avec l’arrivée du zapatisme (participation aux assemblées, prise de charges/mandats, etc.), les zapatistes reconnaissent toutefois qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Beaucoup de femmes hésitent encore à participer aux activités « politiques », par manque de confiance ou, pis, parce que, dans certains cas, certains maris ne les laissent pas faire. En réaction à ces résistances internes, le caracol de La Garrucha a d’ailleurs lancé une sorte de campagne de sensibilisation, à l’aide, entre autres, d’affiches intitulées « ¡Participa ! ». Un des maestros, reconnaissant que « le machisme existe encore », a souligné la nécessité pour les hommes « de réfléchir à comment éduquer leurs fils pour que cela disparaisse ». En tout cas, ce qui est remarquable, c’est l’honnêteté dont ont fait preuve nos hôtes et enseignants sur cette question délicate, évitant la langue de bois et les mensonges pour reconnaître une réalité à changer.
Bien d’autres thèmes ont également été abordés (la formation de l’EZLN, l’insurrection du 1er janvier 1994, les projets de contre-insurrection du gouvernement, les travaux collectifs, le système d’éducation autonome), mais cet article n’est pas l’espace adéquat pour tout déballer. Notons encore, toutefois, un dernier point sur lequel nos enseignants en passe-montagne ont beaucoup insisté et qui ne peut que trouver un écho sous nos latitudes : le combat social n’a pas de frontières et doit être mondialisé. Dans l’une des dernières interventions de la journée, un des maestros a d’ailleurs déclaré cette phrase que je me suis empressé de noter : « Nous ne cherchons pas à avoir seulement une partie [de territoire], nous voulons un changement global, pour tout le Mexique, pour le monde entier. » Et cette révolution mondiale tant souhaitée ne saurait s’exprimer à travers l’imposition aux peuples d’un système précis (fût-il zapatiste) ; non, c’est aux peuples du monde – à ceux qui souffrent, à ceux qui réclament plus de liberté et de justice – de se prendre en mains et de penser et construire leurs révoltes et leur révolution. Les zapatistes ne veulent pas d’un monde uniformément zapatiste, mais d’un « monde qui contient plusieurs mondes » (et non tous les mondes, certains étant parfaitement incompatibles avec l’émancipation).
À 18 heures, je monte, avec quelques autres élèves, dans une bétaillère et je prends le chemin de la communauté de mon votán. Celle-ci, baptisée Querétaro, se trouve à une petite demi-heure du caracol, dans un endroit magnifique, entouré de montagnes et plongé dans la verdure. Une fois sur place, alors que le soleil commence à décliner, nous la traversons jusqu’à une petite clairière vallonnée (j’apprendrai peu après qu’il s’agissait d’une terre récupérée par les zapatistes en 1994) où nous attendent les familles qui nous hébergeront pour les prochains jours. Un chaleureux discours de bienvenue est prononcé à notre arrivée, puis l’hymne zapatiste est entonné a capella par tout le monde. Après avoir serré la main de chacun des présents, chaque élève retourne auprès de son votán, lequel présente la famille qui le prendra en charge jusqu’à la fin de la semaine. C’est ainsi que José Martínez me conduit chez lui. Son foyer se compose de trois petits bâtiments en bois de pin construits autour d’une petite cour où se baladent poules et cochons. L’un d’eux, au toit en cannes, est la cuisine ; les deux autres – aux toits en tôle – sont des maisons à proprement parler, la sienne et celle de sa sœur. Je m’installe pour ma part dans la sienne, laquelle est, à l’intérieur, très sobre : un lit avec moustiquaire, une table, un autel religieux (mon votán et sa famille sont catholiques), des machettes. Aux murs, on trouve, pour seule décoration, une photo du sous-commandant Marcos découpée dans un journal et deux posters racontant chacun une légende indienne mexicaine. En entrant dans la pièce, mon votán insiste beaucoup sur le fait que la table m’est exclusivement réservée, qu’il s’agit de mon bureau pour étudier, dans les meilleures conditions possible, les quatre manuels après le travail de la terre.
Après le repas (café, tortillas et frijoles), José Martínez me fait comprendre qu’il est justement temps, pour moi, de me plonger dans les livres. J’obtempère et en entame la lecture, l’interrompant régulièrement pour questionner mon votán sur certains points. À 22 heures, après un bain à la bassine et à l’eau froide (qui n’est pas du luxe, car s’il pleut parfois très fort dans la région, il fait aussi très chaud), je me mets au lit, dans un hamac. Jusque-là, je pensais que mon votán et sa famille dormiraient dans leur maison habituelle, avec moi. Mais, au moment où je m’apprête à me coucher, il m’informe qu’il me laisse sa maison pour moi tout seul. J’ai beau insisté, dire que ce n’est pas la peine, que je peux très bien la partager avec eux, rien n’y fait : lui et sa femme iront dormir chez sa sœur. Soit. Je ne peux qu’accepter, un peu gêné. Et ma première nuit dans la communauté se passera plutôt bien, même s’il fait froid et bien que mon petit estomac de classe moyenne française citadine semble avoir du mal à digérer les nombreux frijoles avalés pendant la journée…
(À suivre.)