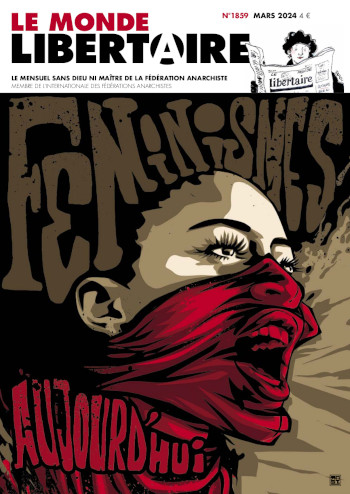Lady sings the blues : être femme, noire... et pauvre !
mis en ligne le 28 janvier 2011
En 1998, Angela Davis publie Blues Legacy and Black Feminism et, à travers les parcours de Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday, n’hésite pas à parler de « féminisme noir ». Par leur comportement, ces femmes se sont battues contre la triple domination dont elles étaient victimes : en tant que femmes, en tant que noires et en tant que pauvres pour la plupart. Rappelons qu’à ses débuts, le blues était essentiellement chanté par des hommes, la variété étant davantage le terrain de la gent féminine. Pas facile de vagabonder avec des mouflets accrochés aux jupons… C’est pourtant une femme (blanche !), Sophie Tucker, qui enregistra le premier blues, « St-Louis blues », en 1917, suivie trois ans plus tard par Bessie Smith avec « Crazy blues ». Il n’est pas du tout facile de se faire une place dans ce monde d’hommes. Cette jalousie est-elle à l’origine du terrible machisme qui caractérise l’univers des musiciens de jazz et de blues, comme s’interroge Buzzy Jackson dans Chanteuses de blues (2006) ou que constate également Marie Buscatto dans Femmes du jazz : musicalités, féminités, marginalités (2008) ? En 1954, Billie Holiday chante « Lady sings the blues », affirmant ainsi que les femmes peuvent aussi avoir le blues… et le chanter ! Selon John Hammond senior, Billie incarne l’élégance des déclassés car, issue du milieu de la prostitution d’Harlem, elle exerce un attrait considérable sur tous ceux qui s’écartaient des normes sociales. En 2006, dans son album Dreamland Blues, Erja Lyytinen, venue de Finlande, nous explique aujourd’hui ce qui continue à pousser une femme à jouer du blues dans « Why a woman plays the blues ».« It hurts me too »
On doit à Ma Rainey un premier plaidoyer en 1928 contre les violences conjugales et les mauvais traitements dans « Black eye blues », sujets malheureusement toujours d’actualité et dont les Carolina Chocolates Drops éditeront une reprise en 2007. En juin 1926, elle se joint à Ida Cox pour exprimer la méfiance envers le partenaire avec « Trust no man », deux ans après que celle-ci a chanté « Wild women don’t have the blues », dans lequel elle s’adresse aux femmes : « Ne soyez pas honnête avec votre homme car lui ne le sera pas/Et il aura vite fait de se dénicher d’autres femmes/Ne soyez pas un ange, devenez une femme sauvage/Pour chasser votre homme de la maison s’il vous traite mal/Les femmes sauvages n’ont jamais le blues. » En 1990, le groupe féminin Saffire en fera une interprétation moderne dans The Uppity Blues Women. Au sujet des violences exercées contre les femmes, comment ne pas évoquer le cas de Tina Turner dans « A fool in love ». On la découvre alors dans sa première apparition enregistrée aux côtés d’Ike et ce titre révèle déjà sans le savoir toute l’ambiguïté de leur relation placée sous les signes de l’amour et de la violence. Ils continuent en 1986, avec « Too much for one woman ».
« Any woman’s blues »
Dans « I ain’t goin’to play no second fiddle » (1925), Bessie Smith fait savoir à son compagnon qu’elle n’a pas l’intention de jouer les seconds rôles dans leur relation. Elle fait explicitement savoir qu’il est hors de question qu’elle le partage avec quelqu’un d’autre. Enregistré deux ans plus tard, dans « I used to be your sweet mama », elle va encore plus loin et se pose à l’égale de l’homme. L’exigence de justice porté par Bessie était importante non seulement pour ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, mais aussi dans le domaine plus vaste des relations entre Noirs et Blancs. Elle véhicule ainsi l’image de la femme qui s’affirme et qui s’émancipe. Lorsqu’elle chante en 1941 « Me and my chauffeur blues », Memphis Minnie poursuit la voie tracée par ses aînées et dénonce dans sa chanson la dépendance des femmes envers les hommes en inversant les rôles.
« Love me tender »
Cependant, la domination dans les rapports sexuels n’est pas la seule forme d’aliénation patriarcale. Dans « Washwoman’s blues » (1928-1929), Bessie évoque la pénibilité des tâches ménagères : « La vie de blanchisseuses, ça n’a guère de bons côtés », chante-t-elle. Dans « Work house blues » (1923-1924), elle décrit les travaux de force, les labours et les corvées domestiques. Sur ce thème, on peut penser aussi à Penny Pope qui enregistre en 1930 « Tennessee workhouse blues ». Le travail salarié des femmes n’était pas de tout repos ; dans les champs ou dans les maisons des Blancs comme nous le rappelle Bumble Bee Slim en 1936 dans « Meet me in the bottom » : « Vous les Blancs, par pitié/ne donnez pas de boulot à cette fille, hoooo/elle est mariée et je ne veux pas qu’elle bosse trop dur ! » Cette idée que les femmes ne sont pas des fainéantes (et que leur place n’est pas à la maison !) est reprise par Sue Foley en 2004 dans « Hardworking woman » et par nos compatriotes de Malted Milk dans l’album Sweet Soul Blues sorti en 2010 ! Profitons-en pour signaler que les hommes, même s’ils ne sont pas très nombreux, ne restent pas totalement sourds aux revendications féminines : Sonny Terry et Brownie McGhee, JB Lenoir, et plus près de nous T-Bone Burnett, reprennent le titre de Buster Brown : « Don’t dog your woman ». De son côté, Detroit Junior enregistre en 2002 « It’s Bad to Make a Woman Mad ».
« Roll with me Henry »
Voici maintenant un authentique témoignage de la censure puritaine sous forme d’une petite histoire… En 1954, Hank Ballard sort « Work with me Annie » qui affirmait fort virilement la supériorité masculine. Dans le courant de l’année suivante, Etta James y répond dans « Roll with me Henry » mais le titre ayant été jugé trop suggestif (« Baise avec moi, Henry »), on a rebaptisé la chanson « The wallflower » avant de l’appeler dorénavant « Dance with me Henry ». Reprise par Georgia Gibbs cela deviendra un tube… chez les Blancs ! Dans « W-O-M-A-N », en 1955, c’est à Muddy Waters qu’elle s’en prend en pastichant dans l’intro la célèbre chanson machiste de Muddy, « I’m a man », l’année même de sa sortie. Provocatrice, elle avertit le « mâle » qu’il va falloir qu’il assure, mais revendique aussi du même coup le plaisir sexuel féminin alors que la notion de plaisir au cours du coït était exclusivement réservé à l’homme dans le code moral de bonne conduite de la société réactionnaire et conservatrice de l’époque. Donna Greene reprend cette idée en 2008 avec « A girl’s gotta have a little pleasure ». Dans « You can have my husband », au départ une chanson de 1960 reprise plus tard par Koko Taylor, celle-ci va subtilement la transformer et, preuve que les temps et les mentalités ont changé, elle chante « You can have my husband, but let me the maid… » qu’on pourrait traduire par « profite de mon mari si tu veux, mais laisse-le moi pour faire le ménage ».
La domination patriarcale c’est aussi le mariage, et le sentiment de propriété sur un(e) individu(e) que fustige Sue Foley dans Ten Days In November en 1998 avec le titre « She Don’t Belong To You ». Et puis aussi les stéréotypes esthétiques, qu’évoquent avec humour Mildred Bailey dans « Scrap your fat » et avec plus d’emphase encore Candy Kane dans « You need a big fat mama », qui milite pour la reconnaissance des femmes fortes… à noter encore qu’on ne commence à envisager des « droits » aux femmes, même s’ils sont encore réservés à la sphère privée, qu’en 1946 et on reconnaît enfin qu’une femme a le droit de faire le choix de son partenaire dans « Woman’s got a right to change her mind » attribué à J.C. et Irene Higginbotham, puis repris par Dave Alvin en 1993 et Jan Buckingham en 2003.
Dieu est une femme… et elle est noire !
Candye Kane fait allusion à cette blague en vogue dans les milieux progressistes des états-Unis des années 70, « les astronautes ont croisé Dieu en allant sur la Lune… Elle est noire ». Avec « The Lord was a woman » paru dans Diva La Grande (2002), elle continue à déranger l’ordre patriarcal. Elle n’est pas seule à poursuivre le combat pour l’émancipation féminine en mettant en chanson les mécanismes sociaux qui rendent possible la domination masculine. Non seulement les textes où les femmes ont réussi à mettre en musique leur alienation continuent à être chantés 1, mais en plus, la relève semble assurée et pas seulement au États-Unis, avec de nouvelles compositions 2.
Pour conclure, il convient de saluer le travail de Nina Van Horn qui publie en 2009 un magnifique hommage aux femmes du blues, dans lequel on retrouve outre les portraits de Bessie Smith, Ma Rainey, Memphis Minnie et Billie Holiday, ceux de Victoria Spivey, Georgia White, Mildred Bailey et Odetta. P.
Pascal
1. Koko Taylor reprend en 1978 « I’m a woman » une chanson emblématique du Women’s Liberation Movement dans Double A sides et à sa suite, les Mississippi Heat dans leur album de 2005 Glad Your Mind. Rory Block interprète en 1992 un texte de S. Truth datant de 1851, « Ain’t I a woman ? » ; Bonnie Riatt et Fiona Boyes reprennent tour à tour « Women be wise » de Sippie Wallace et enfin Etta James et Tina Turner chantaient encore récemment « Only women bleed », la célèbre ballade de Dick Wagner écrite en 1968.
2. Joanna Connor signe en 1996 Big Girl Blues qui contient le fameux « Sister spirit », Susan Tedeschi qui reprend « Mama, he treats your daughter mean » dans Just Won’t Burn en 2000, titre également chanté en 2008 par The Philadelphia Blues Messengers dans leur album Blues For Sale, Fiona Boyes, « Woman Ain’t A Mule » dans Blues Woman en 2009, Shemekia Copeland, « When a woman’s had enough » en 2002. Paru la même année, « Woman Down » du Lara Price Band. « Art Of Divorce » chante dans Flavor’s Blues Zakiya Hooker en 2004, tandis que Sharrie Williams interprète en 2006 « How much can a woman take », Kara Maguire revient sur « (this) Woman’s Liberation », dans Nobody’s Girl en 2007. Karen Lovely poursuit avec « Lucky Girl » en 2008.
Cette liste n’est sûrement pas exhaustive, si vous souhaitez la compléter, la discuter ou simplement partager vos réactions, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : comboquilombo (arobase) free.fr