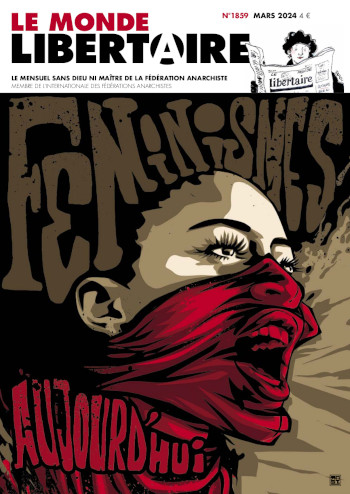Le droit opposable : faillite et triomphe du droit
mis en ligne le 15 juillet 2010
Une condition de l’épanouissement individuel et collectif – la sécurité, la vraie ! – est sans doute d’avoir un abri : hutte, tente, yourte, roulotte pour les populations nomades 1, logement « en dur » pour les sédentaires. Or dans nos sociétés occidentales modernes, la sous-estimation chronique des besoins en logements 2, dans le contexte capitaliste, fait chaque jour davantage de la pénurie une des premières insécurités sociales. Sans-abri 3, mal-logés, personnes sous la menace d’expulsion, c’est en centaines de milliers que se comptent les victimes de la démocratie représentative capitaliste, qui convoque pourtant pour sa légitimité la notion d’État de droit.État de droit et état du droit
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’esprit des révolutions sociales (qui avaient soufflé depuis un siècle et culminé en Europe avec la révolution espagnole de 1936 ouvrant le conflit armé) a introduit quelques bases sociales dans l’ordre juridique de l’État de droit. Le préambule de la Constitution de 1946 (auquel se réfère celle de 1958) est exemplaire. Il s’inscrit expressément en réponse aux fascismes (« au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir la personne humaine […] »), et il en déduit une obligation pour la nation de garantir des droits sociaux (travail, action syndicale, gratuité de l’instruction, de la santé, de la formation et de la culture, services publics vus comme « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »). Mieux encore que garantir l’exercice de droits, ce texte fait obligation à « la nation d’assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Parmi ces conditions figure bien sûr le logement. Parallèlement, ce nouvel État de droit s’était doté d’outils d’intervention effective : les ordonnances de 1945 sur la réquisition, jamais abrogées. Puis, durant les IVe et Ve Républiques, des textes sont censés avoir consolidé un droit au logement, jusqu’à la loi du 31 mai 1990 définissant un droit au logement décent et indépendant.
Or, dans les fondements théoriques des démocraties représentatives issues des révolutions politiques des XVIIIe et XIXe siècles, il y a la séparation des pouvoirs et la hiérarchisation des normes. La séparation des pouvoirs, c’est le fait que l’on sépare, dans l’organisation politique d’un corps social, les organes qui font les lois (législatif), ceux qui administrent en exécutant les lois (exécutif) et ceux qui jugent l’application correcte des lois (judiciaire). La hiérarchisation des normes, c’est le fait qu’en haut on trouve un texte fondateur – la Constitution – qui garantit le cadre politique invariant. Suivent les lois instituées par la représentation nationale (le législateur), puis les ordonnances, décrets et arrêtés pris par l’administration (État, régions, départements, communes) pour mettre en œuvre concrètement ces lois 4.
Dans ce cadre, l’État disposait donc a priori de l’arsenal juridique le plus fort (droit au logement à valeur constitutionnelle, lois multiples, pouvoirs d’administration maximum : la réquisition). Lorsqu’en 2006 l’action du nouvel abbé Pierre (Augustin Legrand et ses Enfants de Don Quichotte), avec des centaines de tentes le long du canal Saint-Martin à Paris, a remis un énième coup de projecteur sur la question du logement 5, le premier constat aurait dû être celui de la faillite complète de l’État de droit pour garantir les fondements sociaux minimums. À l’évidence, le législateur n’a pas bien légiféré, l’administration n’a pas bien usé de ses pouvoirs et le juge n’a pas sanctionné cette carence grave au droit positif. En soixante ans, le système n’a pas respecté son obligation propre d’« assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », en l’occurrence le logement, et qui passait aussi par une action de construction à la mesure des besoins (c’est une supercherie que ces droits à des biens ou services dont, en tout état de cause, la pénurie est entretenue).
Les anarchistes ont depuis longtemps fait cette critique de l’État, et du lien avec le véritable objectif des dominants en matière de droit : garantir leur propriété sur les moyens de production (voire de plus en plus les moyens de la vie elle-même). Lorsque Christine Boutin, ministre du Logement, est interrogée sur la réquisition – et alors qu’elle vient d’affirmer le caractère fondamental du droit au logement –, elle répond qu’elle « ne croit pas que les réquisitions soient une solution puisqu’en France le droit de propriété est un droit fondamental 6 ». Autrement dit, la vraie hiérarchie des normes est celle qui place le droit de propriété des dominants au-dessus de tout, droit fondamental ou pas !
Mais c’est la réponse de l’État à cette situation qu’il est ici intéressant d’analyser.
Le mal par le mal
Face à la faillite apparente de son droit, fondement et instrument, que croyez-vous que l’État fît ? Il nous gratifia d’un nouveau concept juridique : le droit opposable (droit au logement opposable ou Dalo, instauré par loi du 5 mars 2007).
Techniquement, il consiste pour les sans-abri ou mal-logés à déposer un dossier justifiant de leur incapacité à accéder à un logement décent ou s’y maintenir. Si c’est jugé recevable en fonction des critères posés, l’État a alors l’obligation de proposer un logement adapté à la personne concernée. S’il ne le fait pas, on peut actionner la justice pour faire condamner l’État à une astreinte financière.
En marketing politique, le droit opposable est délicat à positionner dans la gamme. Par nature, un droit est opposable. Pour rester dans le domaine du logement, lorsque le locataire ne paie pas, le propriétaire peut actionner la justice pour le forcer au paiement ou le faire expulser. Et l’on a montré plus haut que l’arsenal le plus complet existait pour que le droit au logement fût déjà un droit opposable. Définir le produit politique « droit opposable », déprécie donc d’un coup toute la gamme existante des droits classiques, qu’il faut pourtant continuer à vendre en attendant le renouvellement complet par la nouvelle génération. Mais l’enjeu est de taille : c’est la manière même de concevoir les droits positifs, qui va concentrer encore plus les pouvoirs entre les mains de l’exécutif, au sein de l’État, en matière de contrôle social.
Un odieux bonneteau
Le Dalo conditionne désormais l’opposabilité (la nature même du droit) à tout un processus bureaucratique confié au préfet (représentant de l’exécutif au sein de l’État) et non au juge. C’est le préfet qui estime les critères de recevabilité justifiés. S’il refuse, on peut soit recourir à une commission de médiation, soit attaquer le refus devant les tribunaux (on a certes à ce stade un juge, mais l’enjeu est simplement l’acceptation du dossier et non pas directement l’obtention concrète du logement).
Cette première étape constitue un filtre efficace vis-à-vis de gens qui ont majoritairement des difficultés à comprendre et rassembler les justificatifs qui auront l’heur de convenir à l’administration. Les associations concernées avaient évalué à 600 000 les cas éligibles au Dalo 7. Or en juillet 2009, dix-huit mois après l’entrée en vigueur, 100 000 dossiers seulement ont été déposés. Nul doute que dans l’écart, il y a ceux qui ignorent leurs « droits », ou ceux qui n’en peuvent plus de toujours devoir justifier leur pauvreté auprès des responsables même de cette pauvreté.
Parmi ces 100 000 dossiers à fin juillet 2009, 66 000 ont été traités et 31 000 acceptés. On a donc à la fois un écrémage par les critères (50 % de refus) et un écrémage par l’inertie du traitement (34 000 dossiers – 33 % – en attente de traitement). Or on parle de gens à la rue ou sous la menace d’expulsion, pour lesquels il est difficile concrètement de garder, alimenter et suivre consciencieusement l’état d’un dossier administratif. Clairement, une partie de ces personnes est perdue en route, ou au mieux devra recommencer à zéro dans un autre département où elles auront atterri (car le système est conçu sur la base géographique du département).
Pour les dossiers acceptés, le préfet doit faire des offres avec les moyens dont il dispose : proposer le dossier de la personne à des bailleurs privés, proposer un logement social. On a vu toutefois que la ministre du Logement exclut la réquisition (alors qu’on estimait à 130 000 les logements vacants à Paris en mai 2008). Vu la pénurie de logements et la concentration des problèmes dans les grosses agglomérations, l’action concrète des préfets est limitée. Sur les 31 000 dossiers acceptés à fin juillet 2009, seulement 12 000 ont fait l’objet de propositions.
Pour les 60 % recalés, ils peuvent enfin recourir au juge pour condamner l’État à une astreinte journalière. Début 2009, suite aux premiers recours, le gouvernement a alors fait voter un plafonnement de l’astreinte selon le type de logement demandé. S’agissant de pauvres dirigés vers le logement social, ce ne sont plus jusqu’à 100 euros/jours que les juges peuvent ordonner, mais seulement de 10 à 30 euros/jour selon le cas. L’État s’achète ainsi la possibilité de ne pas agir.
600 000 foyers au départ, et à l’arrivée : rien pour 500 000, un recours hypothétique au niveau de la recevabilité pour environ 70 000, une indemnisation ridicule pour environ 20 000, et un logement accepté (à défaut d’être acceptable !) pour à peine 10 000. Voilà le bilan, côté citoyen, de ce nouveau produit politique du droit opposable, appliqué à une obligation de l’État à valeur constitutionnelle. On n’ose imaginer pour une obligation de degré inférieur…
Apartheid social
Côté État, c’est le jackpot. D’une part, on a ramené encore plus des mains du judiciaire à celles de l’exécutif la maîtrise d’un droit fondamental. Les anarchistes n’ont pas une confiance exagérée dans la justice bourgeoise, mais le peu de pression qu’elle pouvait encore exercer (niveau de l’astreinte par exemple) a été neutralisé.
D’autre part et surtout, une autre modification lourde a été apportée en février 2009 : la possibilité pour les préfets en Ile-de-France de proposer des logements dans n’importe quel département de la région. Ce qui explique que sur les 12 000 propositions d’abri précitées, plus de 2 300 ont été refusées par les « bénéficiaires ».
Car le logement social est non seulement insuffisant, mais il est en outre le reflet de la construction spatiale des inégalités 8. Sur le plan individuel déjà, même pour celui qui vit dans un taudis ou dans la rue, à Paris ou proche banlieue, se voir proposer un logement au fin fond de la Seine-et-Marne ou au cœur des cités les plus dégradées de Seine-Saint-Denis, n’est évidemment pas un logement « adapté ». Mais sur le plan des mécanismes sociaux à l’œuvre, il faut saisir l’enjeu territorial très fort de la maîtrise des centres pour la classe dominante. Un des aspects de la question de l’immigration qui occulte celle de la classe ouvrière, réside en ce que les seuls espaces urbains centraux encore populaires sont les taudis occupés par les immigrés récents (et notamment sans-papiers), alors que le reste des classes populaires est déjà majoritairement rejeté vers la grande banlieue pour les employés, et les espaces ruraux (qui ne sont plus des campagnes) pour les ouvriers.
Dans cette perspective, le Dalo devient un outil légal que s’est donné la classe dominante pour achever ce processus d’apartheid social, qui lui garantit la maîtrise exclusive des centres pour ses lieux de vie et de décision, sans rien perdre de la maîtrise des périphéries pour les lieux de production.
De quel droit ? 9
Après l’emprise de l’exécutif sur le législatif (85 % des lois sont proposées par le gouvernement et non par le Parlement, lequel est en tout état de cause inféodé au gouvernement), c’est au tour du judiciaire d’être dépossédé de ses pouvoirs propres. Ainsi, la séparation des pouvoirs comme la hiérarchie des normes sont niées, dans le respect des règles internes du système (le Conseil constitutionnel par exemple n’a jamais rien trouvé à redire). Car ces parties de bonneteau politique ne se font pas contre le droit, mais bien au nom du droit. Le droit opposable, qui devrait apparaître comme la faillite du droit, est en réalité son triomphe. Triomphe de l’État de droit, dont le vaincu une fois de plus est la question sociale, c’est-à-dire une articulation concrète de la liberté et de l’égalité, organisant la création et la répartition des richesses (matérielles et culturelles), pour l’émancipation individuelle et collective, et contre les mécanismes de dominations.
Ces enjeux à l’œuvre dans le droit opposable sont d’ailleurs à resituer dans une évolution de l’approche des institutions publiques, et donc du droit, dont le dernier pas est l’institution du « Défenseur des droits » venant remplacer la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), le Défenseur des enfants, le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, la Commission nationale du débat public (CNDP), la Commission nationale informatique & libertés, etc., qui ont pu parfois entrouvrir un timide judas sur les injustices et les oppressions de l’État 10.
S’il fallait encore en faire la démonstration, l’on voit ici que démocratie et dictature ne s’opposent pas mais sont deux degrés d’une même échelle : celle de la minorité des oppresseurs vis-à-vis de la majorité des oppressés.
En face, dans le camp de la résistance, on ne peut faire non plus meilleure démonstration de la légitimité de l’action directe comme outil d’intervention. À la lisière, on notera l’initiative du Comité de libération de l’immobilier privé (Clip) qui cherche, sur le modèle germano-suisse du Mietshäuser Syndikat, à articuler des modes d’occupation autogérés à l’intérieur d’une réalité juridique actuelle bourgeoise 11. L’objet d’un prochain article ?
Otis Tarda, groupe Louise Michel
1. Sur le nomadisme, lire Denis Couchaux, Habitats nomades (éd. Alternatives, coll. Anarchitecture), ainsi que l’article « Un territoire bâti comme une tente nomade » d’Hélène Claudot-Howad, Réfractions, n° 21, 2008. Sur les rapports entre identité(s) et territoire(s), lire l’ensemble du numéro 21 de Réfractions (refractions.plusloin.org).
2. Pour une critique technique de la carence des estimations par l’Insee, lire l’article de Patrick Grépinet, dans le numéro du 22 septembre 2006 de l’hebdomadaire Le Moniteur des Travaux Publics.
3. Le terme SDF (sans domicile fixe) est pervers. Les vrais SDF sont les grands de ce monde, qui ont plusieurs domiciles : 183 jours minimum en Suisse, ou au Lichtenstein pour justifier du bénéfice des conventions fiscales, tous les quatre matins à Paris, Londres ou New-York, pour y mener leurs affaires, une semaine de-ci de-là aux îles Caïmans pour un point avec le banquier, des vacances en palaces exotiques et protégés, etc. Le sans-abri, lui, n’a pas de domicile. Le désigner comme SDF, c’est être complice de l’inversion du sens des mots, qui est toujours le fait du pouvoir, et c’est colporter la morale bourgeoise stigmatisant l’errance et la pauvreté comme la sanction de l’inconstance et de la faiblesse morales.
4. J’ignore ici volontairement la question des conventions internationales dans la hiérarchie des normes, car il y aurait matière à un article sur ce seul sujet !
5. à noter que la tente, archétype d’un mode de vie nomade, est amenée au cœur des villes, lieux de sédentarité, comme révélateur de l’absence d’abri, mais jamais pour bousculer l’imaginaire et interroger la possibilité de nouveaux nomadismes.
6. Interview dans Métro du 15 mai 2009.
7. L’ensemble des chiffres qui suivent est repris des coupures de la presse quotidienne rassemblées depuis janvier 2008.
8. Sur ces questions, lire l’Atlas des nouvelles fractures sociales en France de Christophe Guilluy et Christophe Noyé (Autrement, 2006), ou encore le dernier livre de Jean-Pierre Garnier, Une violence éminemment contemporaine, Essais sur la ville, la petite-bourgeoisie intellectuelle et l’effacement des classes populaire (Agone, 2010).
9. J’emprunte cet intertitre au n° 6 de Réfractions, 2000 (De quel droit ? Droit & anarchie), qui comme les autres mérite le détour : refractions.plusloin.org.
10. Pour une critique légaliste du Défenseur des droits, lire l’article de Geneviève Koubi, « Recoins constitutionnels : le défenseur des droits », juillet 2008, koubi.fr/spip.php?article117
11. habitatgroupe.org/spip.php?page=article_pdf & id_article = 220